Omar Abdul Aziz : La Vérité comme exigence, un engagement sans relâche
Par Alamir Kamal Farag .Publié le
2025/10/07 09:09

Octobre. 07, 2025
Il est de notoriété publique que l'ère des grands philosophes serait révolue. Beaucoup croient que le monde arabe, après avoir connu un âge d'or de penseurs qui ont éclairé les chemins de la connaissance – tels Al-Kindi, Al-Farabi et Avicenne – souffre aujourd'hui d'une certaine stérilité intellectuelle. Bien que toujours féconde en création littéraire, elle semblerait incapable d'assurer le renouveau éclairé et la pensée philosophique profonde.
Certes, notre époque moderne a vu émerger de nombreux intellectuels qui ont enrichi la scène par leurs ouvrages, leurs théories et leurs visions, à l'instar de figures comme Mohamed Abed Al-Jabri, Mohammed Arkoun, Hassan Hanafi, Zaki Naguib Mahmoud et Mahmoud Amin Al-Alem. Pourtant, le penseur-philosophe au sens noble du terme est resté une denrée rare.
Cependant, cette perception s'est rapidement estompée lors de ma première rencontre avec le penseur arabe yéménite, le Docteur Omar Abdul Aziz, et à l'écoute de ses idées et de ses réflexions.
Un intellectuel aux multiples facettes et aux horizons multiples
Le Dr. Omar Abdul Aziz est une figure intellectuelle majeure et un pôle yéménite. Il est à la fois écrivain, romancier, artiste plasticien, penseur, philosophe, et érudit en soufisme, en linguistique et en esthétique. Il est le porteur d'une vision intellectuelle profonde et d'une théorie philosophique singulière sur le cosmos et l'existence.
Né de parents yéménites installés en Somalie — alors sous occupation italienne — Omar Abdul Aziz a été scolarisé dans le système italien. Cette trajectoire lui a ainsi offert une confluence de sources culturelles diverses : le creuset arabo-islamique, spécifiquement yéménite, l'apport somalo-arabo-africain, et enfin la richesse italo-latine.
En l'espace de cinquante ans, le Dr. Omar Abdul Aziz a produit plus d'une centaine d'ouvrages dans des domaines variés : du roman à l'essai, des visions philosophiques aux études critiques et aux analyses de la littérature populaire.
Un leader culturel et un passeur de savoir
Grâce à sa position de Directeur de l'Administration des Études et des Publications au sein du Département de la Culture du Gouvernement de Sharjah, il a contribué à l'édition de centaines de livres et a soutenu et mis en lumière des générations d'écrivains et d'auteurs.
Le Dr. Omar Abdul Aziz possède également une expérience journalistique pionnière. Outre sa fonction de rédacteur en chef de la revue culturelle Al-Rafid, il a lancé l'ouvrage Al-Rafid Numérique, posant les jalons de la numérisation culturelle et transportant le livre arabe du monde du papier vers l'espace internet.
En tant que Président du Conseil d'Administration du Club Culturel Arabe de Sharjah, le Dr. Abdul Aziz mène un courant culturel de qualité à travers de nombreux événements qui attirent divers créateurs, contribuant activement à façonner le visage de Sharjah, première Ville Culturelle Arabe.
Le Dr. Omar Abdul Aziz est doté de nobles qualités : c'est un professeur, un mentor et un guide qui propage de belles valeurs. Ses conversations révèlent une intelligence vive, une perspicacité instantanée et une culture foisonnante. Sa vision intellectuelle porte une empreinte singulière, imprégnée d'un sens de l'arabité profond et authentique.
Dans cet entretien ouvert — qui sera mis à jour dans le cadre du journalisme ouvert —, le Dr. Omar Abdul Aziz aborde diverses questions intellectuelles et philosophiques. Il dévoile une grande partie de son projet intellectuel et sa vision éclairée dont nous avons cruellement besoin en cette étape cruciale de notre histoire arabe.

La Culture Yéménite : Un Tissu Vivant et Ancien
La culture yéménite est riche, un tissu vibrant tissé de traditions, de religion et de coutumes tribales. Quel a été l'impact de cette culture sur votre parcours ?
La culture au Yémen est une partie intrinsèque de la culture arabe dans son ensemble. C'est le support linguistique qui distingue une culture d'une autre, et c'est ce qui confère à toute culture sa légitimité expressive et intellectuelle. L'équation culturelle arabe tire son essence d'une source unique, dont le Saint Coran est le sommet, précédé par les prémices rhétoriques antérieures à l'Islam. La poésie rythmée et la prose rimée, chargées de lyrisme et de musicalité, sont des héritages immortels de la langue arabe préislamique.
Le Yémen géo-historique fut un foyer fertile pour cette culture linguistique. Il a bénéficié, à l'époque, de convergences linguistiques avec les langues historiques couchitiques, qui se sont reflétées dans les anciennes civilisations yéménites de Saba, Himyar, Qataban, Ma'in et Hadramaout.
Cette culture s'est manifestée tant dans l'expression orale que dans l'écriture, reflétant l'équilibre esthétique (mîzân al-jamâl) de ces affluents linguistiques qui servirent de puissants catalyseurs à la langue arabe que nous connaissons aujourd'hui.
Depuis cette époque lointaine, l'arabe a maintenu une stabilité unique, rare dans l'histoire des langues écrites. J'ai eu la chance d'utiliser l'arabe comme langue quotidienne de discours et de communication dans le quartier où je suis né à Mogadiscio. Mon appréciation esthétique (mes "algorithmes de réception esthétique") a été renforcée par le Saint Coran, les hymnes religieux prophétiques (Mawāshih), et l'écoute quotidienne de musique via les radios arabes diffusant sur ondes moyennes et courtes. J'ai également bénéficié d'une éducation primaire italienne qui résonne encore en moi comme un rêve d'été éphémère, car j'ai abandonné l'italien après la première école et les films doublés, pour me consacrer à l'enseignement en arabe et en anglais. La langue somalienne était toujours généreusement présente, tandis que le roumain m'a rattrapé plus tard au cours de mes études universitaires et au-delà.
L'Affluent Roumain : Une Résonance Latine
Vos études en Roumanie ont ajouté un affluent culturel important, notamment l'économie à l'Université de Bucarest. Parlez-nous de cet apport et de son impact sur votre pensée et votre créativité?
Mon séjour en Roumanie fut une reconnexion avec l'italien que j'avais laissé derrière moi après l'école primaire. Il faut savoir que le roumain est une langue d'origine latine, tout comme l'italien, l'espagnol, le portugais et le français. Mais la synergie entre l'italien et le roumain dépasse les simples significations lexicales pour toucher à la conjugaison des verbes, et même à la construction "audio-visuelle" des phrases, ce que nous ne pouvons détailler ici.
À mon arrivée en Roumanie pour étudier la langue avant l'université, je me suis trouvé captivé par la nostalgie du passé italien. Les mystères de l'inconscient, enfouis au plus profond de mon cerveau, se sont allumés. Il en a résulté que je parlais roumain en un mois de cours préparatoires. Je crois fermement que cela n'était pas dû au seul effort d'étude, mais bien à un inconscient latent qui m'a rapproché du roumain, au point qu'après des années, je pensais en roumain, et l'arabe et l'anglais s'éloignaient de moi.
Cependant, cette équation s'est rapidement inversée après mon retour à Aden, où j'ai retrouvé l'intégralité de l'héritage littéraire arabe et me suis pleinement identifié à cette période créative des années quatre-vingt qui suscite tant de nostalgie chez ma génération.
Quant à l'affluent roumain dans ma culture, je le résume ainsi : j'ai étudié les sciences économiques dans leurs diverses branches comme une obligation académique incontournable, tout en restant passionné par les mathématiques, la pensée économique et les sciences qui en découlent. Les conférences les plus fascinantes pour moi portaient sur les matrices mathématiques, la théorie économique et la théorie monétaire (financière). Cependant, cette étape universitaire n'était qu'un petit ruisseau dans le cours de ma passion dévorante pour la philosophie, l'esthétique, les projections cinématographiques, la visite d'expositions d'arts plastiques et l'écoute de la musique orchestrale in situ.
Les ouvrages en roumain m'ont offert une opportunité exceptionnelle de connaître l'histoire et la philosophie des arts et des lettres. Ces lectures m'accompagnent encore aujourd'hui, et j'y ai découvert de nombreuses traductions introuvables en arabe, notamment celles concernant la littérature historique européenne.
Mais l'étape des années soixante-dix de l'après-guerre mondiale ne s'arrêtera pas là. Ses effets se poursuivront avec mon retour pour compléter mes études supérieures dans les années quatre-vingt-dix, ce siècle de folie et de transformations dévastatrices dans l'ensemble du système mondial, héritier de la folie guerrière qui a préparé l'Apocalypse en Europe et dans le monde.
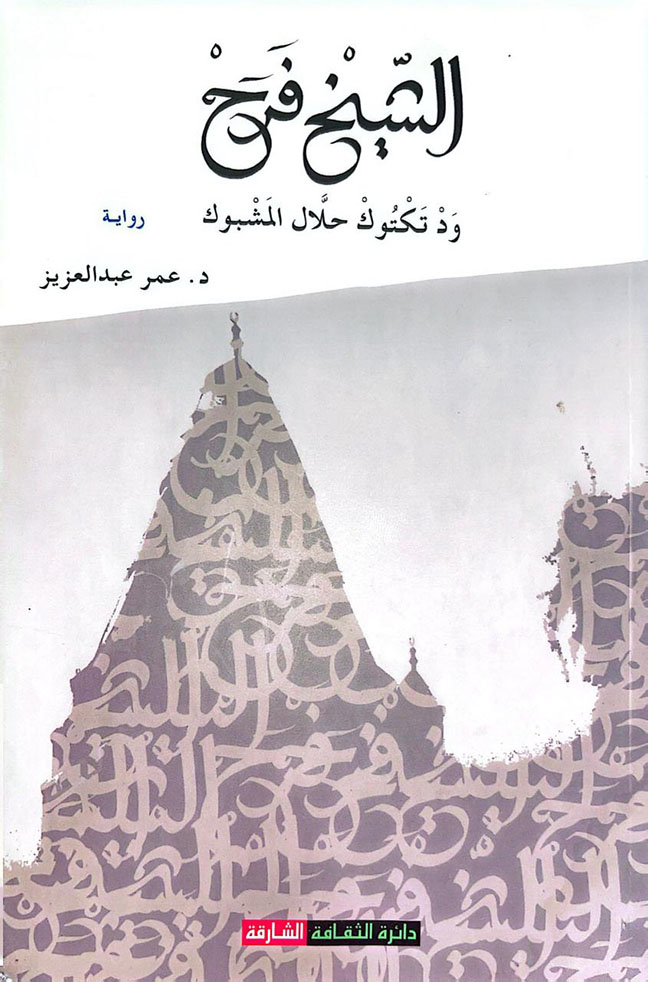
Les Connexions Linguistiques : Un Cordon Ombilical Commun
Selon votre expertise en linguistique, les arts de l'expression littéraire sont fondamentalement unifiés, nourris par un seul cordon ombilical. Quelles sont les connexions que vous avez ressenties entre les langues ?
La diversité des langues humaines dans mon parcours existentiel était inscrite dans le destin. Je suis né de parents yéménites, et j'ai prospéré avec la langue de ma grand-mère somalienne, qui fut ma grande inspiratrice. Elle puisait le nectar de son existence dans l'air, jouait les mélodies de ses spiritualités dans l'eau, s'informait sur nos morts, nous parlait de nos voyageurs absents, et transformait la terre en or à volonté. Elle s'exprimait dans un somalien mélodieux avec une exécution orchestrale polyphonique, et elle nageait dans les airs si elle manquait d'eau.
Les Connexions Linguistiques : Un Cordon Ombilical Commun
J'utilisais le dialecte arabe Hadrami à la maison et dans le quartier, le somalien dans la communauté en général, et l'italien à l'école primaire. Les algorithmes oraux de ces multiples idiomes s'ordonnaient dans un seul et unique programme. Chacune de ces trois langues trouvait un pont de communication fluide avec les autres, comme si elles provenaient d'une source unique. C'est une vérité dont j'allais me convaincre après de longues années.
Je crois avec certitude que les langues humaines proviennent d'une source unique, ou plutôt d'un programme unique qui s'organise autour de la relation binaire algébrique entre la consonne et la voyelle. Cette relation binaire, apparemment conflictuelle, converge expressivement, tout comme les instruments à cordes s'harmonisent avec les rythmes dans les compositions polyphoniques.
Le langage émane fondamentalement des approches phonétiques humaines (nâsûtiya), ce qui nous permet d'affirmer que l'oralité est la base de toutes les bases du langage. D'où la distinction entre la langue et la parole. Si la langue est porteuse de significations visuelles et sonores, la parole, elle, est porteuse de presque tout. Le grand linguiste Ferdinand de Saussure s'est d'ailleurs attaché à exposer les paramètres de la langue et de la parole.
Je le répète, l'origine du langage est le son émanant de l'être humain, et en ce sens, il procède de sa capacité et de son identité intégrale. Si l'on suppose que les sens de l'ouïe et de la parole chez l'homme sont des fonctions à la fois de communication et de réception, ces deux sens ne peuvent remplir leur fonction sans le reste du corps. Ils agissent comme deux grands gouvernails pour des dizaines, voire des centaines et des milliers d'autres étoiles dispersées dans le miracle de l'entité humaine. C'est pourquoi l'on dit que le programme du langage déposé dans l'humanité émane du Divin, et qu'il s'agit d'un programme unique dont les variations orbitales absolues se distribuent selon la multiplicité des créatures dans leurs caractéristiques distinctes.

La Convergence des Arts : Des Mondes Visibles aux Abstractions Inconnues
En réalité, tous les arts proviennent d'un seul programme créatif. J'entends par là le temps de la création qui unifie toutes les formes d'expression et de communication, qu'elles soient verbales, chromatiques, cinétiques, etc.
Tous les arts procèdent des mêmes éléments artistiques qui transcendent les conventions de l'expression. Ils naviguent dans un espace de concrets (le perceptible, le visible) pour finalement atteindre les abstraits (l'invisible, l'insaisissable par l'entendement).
Il y a donc deux niveaux d'expression : le niveau direct lié à l'outil d'expression, qu'il soit littéraire/verbal, chromatique/pictural, ou mélodique/aérien dans l'éther, et même les expressions qui passent par des médias intelligents comme la caméra au cinéma et la scène au théâtre.
Nous avons dit que les règles fondamentales des différents arts sont fusionnées et imbriquées. Elles peuvent être lyriques et scandées par le mot, comme la poésie et la narration, ou chromatiques dans les arts plastiques et la photographie, ou encore des cordes mélodiques dans la musique.
Au sens scolastique, l'art plastique repose sur les éléments de la lumière, de l'ombre, de la masse proportionnelle et de la troisième dimension perspective qui trompe le spectateur non averti. En parallèle, la poésie naît de la dualité entre la révélation et la dissimulation, entre l'énoncé et son contraire, et de la construction musicale et de ses dimensions. Les mêmes lois s'appliquent, de manière plus structurée et complexe, au théâtre et au cinéma. Les différents arts apparaissent alors comme des facettes dispersées d'un même texte. Le critique perspicace n'a d'autre choix que de les considérer comme l'"union dans l'œil de la différence" (jam' fî 'ayn al-farq).
La Correspondance Inter-artistique : Le Code de l'Univers
La correspondance entre les arts est une réalité établie par les études. À travers votre expérience créative multidisciplinaire et votre pratique de plusieurs arts, comment avez-vous réussi à exploiter cette correspondance ?
Dans les premières étapes de mes études, j'ai été captivé par les mathématiques. Je n'ai compris la logique interne de cette "déviation" qu'après de longues années, voire des décennies. J'ai alors réalisé que tous les phénomènes du monde — visibles, audibles et sensibles — sont intégralement inscrits dans un Livre Divin codifié.
Par la suite, j'ai compris que les systèmes de signes et leurs dimensions numériques et alphabétiques émanent du même programme cosmique, accordé jusqu'à l'harmonie. Les systèmes des langues chromatiques, alphabétiques, numériques et mélodiques portent les mêmes lois internes. Le lyrisme visuel dans l'image n'est pas étranger à la construction alphabétique du texte. Les abstractions musicales mélodiques peuvent être traduites en couleurs, en lettres, en chiffres et en images. La structure (le patron) de chaque type d'art ressemble à l'œuvre d'art complète dans les autres disciplines. Les Arabes l'avaient déjà saisi dans leurs premières dénominations des composantes de la qasîda (poème), où l'on trouve colonne , rime , début et fin , toutes étant des métaphores descriptives de la structure architecturale générale.
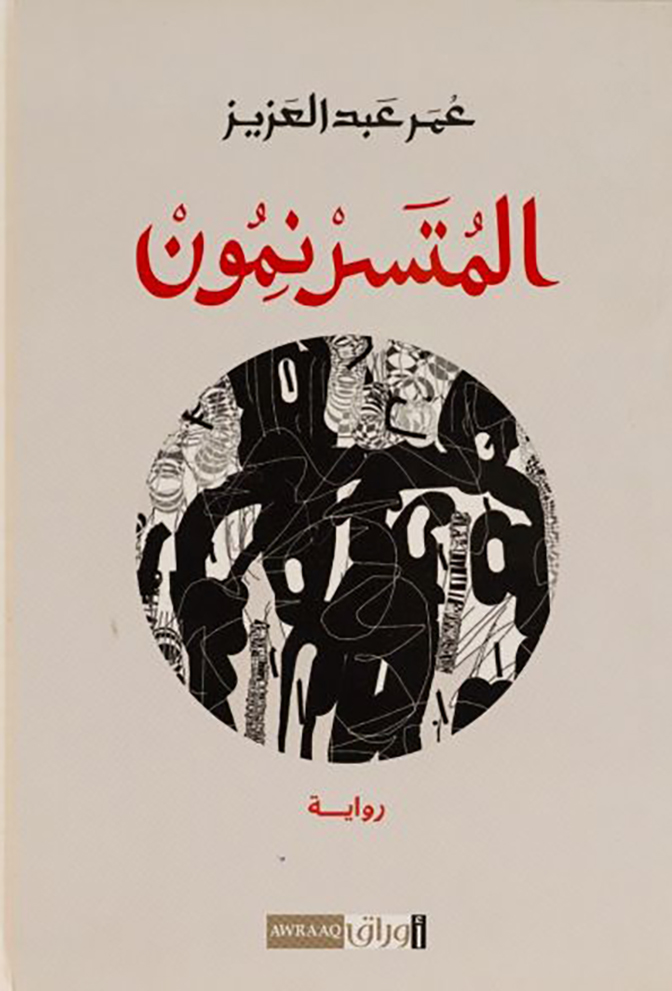
Pensée et Philosophie : La Quête de l'Essence
Comment percevez-vous la relation de la philosophie avec la pensée humaine en général ? Considérez-vous que la philosophie est la base sur laquelle toute pensée créative est édifiée ?
La question de la philosophie est ancienne, elle est intrinsèquement liée à l'existence au sens le plus direct du terme, tout en étant connectée à l'existence invisible. Pour cette raison, la question philosophique demeure une question sans réponse au sens strict du mot. C'est la question qui n'a pas de réponse, dans le sens où elle génère du sens à partir du sens.
Par conséquent, la philosophie est une forme de voyage dans l'abstraction : un déplacement du concret, du visible, du perceptible et du défini, vers l'abstrait, le non-palpable, l'imperceptible et l'indéfini.
De par sa nature, la philosophie est donc contemplative et, par ses approches, elle est également de nature relative. C'est pourquoi la philosophie continue de s'occuper des universaux (al-kulliyyât), ce qui inclut les essences (al-mâhiyyât), le fond des choses, ce qui y est latent, et ce qui est absent.
La Philosophie : Une Expression de l'Être Humain
La philosophie est, par conséquent, une forme qui exprime l'être humain (la kénôse ou kénounâ) dans sa dimension la plus abstraite, la plus distillée, et dans sa dimension imaginaire. C'est pourquoi le philosophe est celui qui transcende tout ce qui est concret, tout ce qui est visible, et qui cherche les essences et les profondeurs (al-jawâhir wa-l-maknûnât) au-delà de ces phénomènes.
Ces essences et ces profondeurs sont par nature semblables à un iceberg flottant dont on ne voit que la pointe. Dans ce sens, les chercheurs, à travers l'histoire et les écrits, ne sont jamais parvenus à une définition catégorique de la philosophie, si ce n'est la dérivation verbale ou terminologique qui l'associe à l'amour de la sagesse (philosophia), comme chez les Anciens.
Mais qu'est-ce que la sagesse ? Si nous examinons la question de plus près, nous constatons que la sagesse est d'une nature et d'une signification largement abstraites, mais aussi fortement morales et esthétiques. C'est donc, pour reprendre le langage philosophique, à la fois esthétique, éthique (aïtika) et lyrique (lîrik), dans le sens d'une beauté que nulle limite ne saurait circonscrire.

L'Éthique et la Relativité des Valeurs
La sagesse est éthique (aïtika), c'est-à-dire morale, or la morale est relative : chaque société a son éthique, ses propres tempéraments dans le traitement des valeurs, des coutumes, des traditions, et même des lois religieuses. Nous ne pouvons même pas parler d'une désignation unique au sein des religions que nous connaissons — comme le christianisme, l'islam, ou toute autre religion — sans la considérer comme multipolaire (mut'addida) par nature.
Les christianismes historiques ne sont pas uniformes, pas plus que les christianismes actuels. Il en va de même pour les « islams » (al-islâmiyyât), si l'on peut s'exprimer ainsi.
Par conséquent, toutes ces questions liées à la sagesse sont, dans une certaine mesure, de nature relative. Elles sont en même temps abstraites, comme je l'ai mentionné, mais aussi nébuleuses (sadîmiyya) — et je le dis au sens positif et transparent du mot.
Décrypter le Fanatisme : L'Ampleur de la Culture Arabe
Les Arabes possèdent de grandes qualités ; la personnalité arabe est reconnue pour sa générosité (karam), sa noblesse (shahâma), et d'autres vertus issues de notre religion et de nos traditions. Mais il existe aussi des défauts, dont le plus dangereux est le fanatisme (ta’assub). Comment déconstruisez-vous l'idée de fanatisme, et quelle est la voie pour le soigner ?
Tout d'abord, il convient de se demander qui sont les Arabes, en réalité. Il existe de nombreuses descriptions : certains parlent d'Arabes originels ('âriba), d'Arabes arabophones (musta'riba), et ainsi de suite.
La vérité est que l'arabité est avant tout une question de langue (lisân), comme toute autre identité nationale sur Terre. Cette langue a vu son rang, sa stature et ses profondeurs exaltés avec l'avènement de l'Islam. Mais elle avait déjà hérité, avant l'Islam — durant la période dite pré-islamique (jâhiliyya) —, de nombreux éléments culturels, linguistiques, et liés aux tempéraments humains. Les Arabes émanent de cette réalité éternelle et historique, qui était en symbiose avec de nombreuses autres cultures et langues humaines.
C'était le cas pour la langue kouchitique yéménite au Sud, ainsi que pour le syriaque et l'araméen au Levant (Shâm) au Nord, et bien d'autres langues. Pour cette raison, je ne peux pas affirmer que l'arabe est isolé des langues humaines. Il en est une partie, mais il est plus englobant au sens phonétique, humain et de la structure écrite. La preuve en est que les caractères arabes couvrent tous les sons accessibles et possibles pour l'être humain, car le programme linguistique chez l'homme est unique et divin, lié à la formation et aux composantes du corps humain.
L'Homme, Orchestre Polyphonique
Par conséquent, les sons émis par l'être humain sont semblables à ceux produits par une série d'instruments de musique classique : il y a des cordes, des percussions, des vents, des instruments à frapper, et ainsi de suite. L'homme porte en lui, dans son corps, toutes ces dimensions. C'est comme s'il parlait en utilisant un langage polyphonique (multi-sons), comme s'il était, par lui-même, un ensemble musical complet. Ceci est une sorte d'analogie religieuse.
Dans ce sens, l'arabe possédait et possède toujours des propriétés phonétiques distinctes de nombreuses langues que nous connaissons, du moins distinctes par sa capacité à gérer les flexions vocales liées aux inflexions syllabiques, comme c'est le cas pour les allongements courts, médians et longs. C'est aussi le cas pour les voyelles brèves (fathât et kasarât), qui peuvent être simples (fatha, kasra, damma), ou doubles, comme pour le tanwîn (par exemple, "an"). La facilité est là, mais je ne souhaite pas détailler les neuf mouvements (harakât) qui se manifestent comme l'émergence d'une consonne (sâkin). Chaque consonne possède neuf mobiles (mutaharrikât), ce qui est inhabituel par rapport aux langues que nous connaissons, du moins anglo-saxonnes et francophones.
Ces qualités de la langue arabe ont conféré aux Arabes une énergie rhétorique et linguistique que des figures comme Al-Jahiz et Abd Al-Qâhir Al-Jurjânî ont exposée avec perspicacité. Elle a également été abordée, directement ou indirectement, par de grands linguistes comme Ferdinand de Saussure et Noam Chomsky. Ainsi, l'arabe fut un précurseur en matière de science de l'interprétation des textes ou herméneutique ('ilm at-ta'wîl). L'herméneutique n'est pas seulement l'explication (tafsîr), c'est la science qui s'empare de la connaissance de l'essence du mot à travers la lettre, le mot, la phrase, et ainsi de suite.
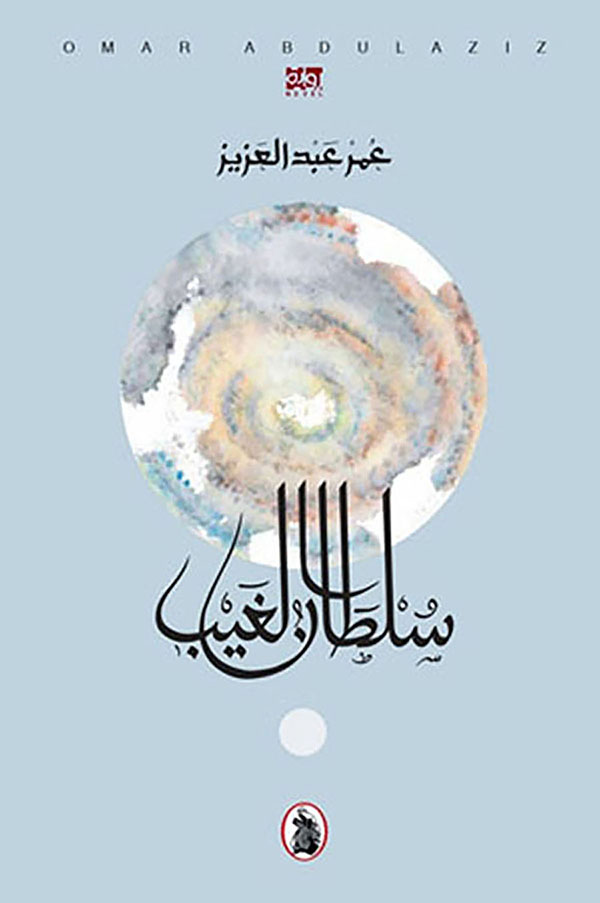
La Dualité du Caractère Arabe
Les Arabes n'étaient pas éloignés des autres civilisations. Ils étaient, par exemple, en interaction avec l'ancienne civilisation égyptienne, elle-même influencée par la pensée grecque et la pensée romaine byzantine. Tout cela existait dans le cadre des intersections et des correspondances entre les différentes cultures.
Les Arabes, au sens ethnique du terme, étaient dans la péninsule Arabique, et la majorité d'entre eux se trouvaient au Yémen, car la profondeur de la péninsule Arabique était au Yémen.
Les Arabes de la péninsule et du Yémen ont acquis leurs qualités morales de la nature de leur environnement. L'environnement des étendues désertiques ouvertes rend l'homme plus endurant (jald) et plus capable de patience (sabr), et ces qualités se reflètent dans ses comportements.
La chevalerie (furûsiyya), l'héroïsme et le courage sont liés au désert. Cet homme qui voyage et migre dans les déserts et les solitudes, affrontant les bêtes féroces sans crainte. La générosité (karam) était également liée à cet environnement, car ils allumaient des feux dans le désert pour que les étrangers puissent voir la tente et y trouver de l'aide.
Ces qualités positives, comme la chevalerie, la générosité et la largesse, étaient toutes liées à la nature, car le désert est une valeur immense. Et quand je parle du désert, je ne parle pas seulement du désert de la péninsule Arabique, mais de tous les déserts arabes, s'étendant de l'extrême sud du Maroc, traversant tout l'Afrique du Nord jusqu'à l'Égypte, puis la péninsule Arabique. C'est le parfum historique du désert arabe. Toutes ces réalités se sont répercutées sur la culture et les comportements des Arabes.
Il existe cependant des aspects négatifs dans la culture arabe historique. Par exemple, le pragmatisme simple et inné qui se manifeste dans le fait de gagner et de perdre (al-maghnam wa-l-maghram). C'est une caractéristique des cultures du désert.
L'homme du désert autorise parfois ce qui est interdit. Il possède donc une capacité d'intrusion à faire certaines choses que ne ferait pas le citadin docile. Le problème réside dans l'individu, car la civilisation est relative. Les plus grandes sauvageries de l'histoire ont eu lieu dans les grandes cités historiques, le sommet de la barbarie se trouvant dans les villes marquées par la dépravation aristocratique et financière, et par la sédentarité couplée au pillage. Quoi qu'il en soit, parler des Arabes serait trop long. Voilà quelques traits caractéristiques de l'arabité.
L'Injustice Faite au Soufisme : Science, Mystique et Révolution Esthétique
Le soufisme est une science, une porte d'accès et une connaissance qui a enrichi la culture arabe. Pourtant, il est parfois victime d'une injustice, que ce soit de la part des chercheurs ou du grand public. Quel est votre avis à ce sujet ?
D’abord, ce terme (al-tasawwuf / soufisme) est apparu ultérieurement à la pratique historique qui l’a précédé. En d'autres termes, ceux qui vivaient en soufis existaient avant l'émergence du terme lui-même. L'ascétisme (az-zuhdiyya), le dépouillement, le renoncement à une grande partie des plaisirs simples de la vie : tout cela était présent et se reflétait dans le comportement des gens que l'on appelait parfois les "Pleureurs" (al-bakkâ'ûn), les "Purifiés" (al-mutahhirûn), ou les groupes largement retirés dans leur intimité, voire les "groupes de la menace morale" (ceux qui interpellent la morale dominante).
En d'autres termes, le mot soufisme est venu après une longue réalité de pratique historique. Même le Christ (paix soit sur lui) incarnait les qualités du soufi au sens strict du terme, de même que de nombreux prophètes et messagers, et beaucoup de ceux qui vivaient dans les déserts et les solitudes, exerçant les métiers de berger ouverts à la nature. Tous ceux-là appartiennent à ce monde : le monde de l'ascétisme.

Une Unité dans la Multiplicité
L'ascétisme est le synonyme du soufisme. Si nous considérons ensuite l'histoire du soufisme dans les cultures arabe et islamique, nous trouvons différentes manifestations : il y a le soufi de l'expression franche (bâwwâh), tel Al-Hallaj ; le soufi de l'extinction (mutatayyir), comme Abû Yazîd Al-Bistâmî ; le soufi omniprésent et universel (shâri' shâmil), tel Muhyî ad-Dîn Ibn Arabî ; et le soufi lyrique jusqu'à l'extase (ghinâ'î) comme Ibn Al-Fârid.
Les attributs de l'extravagance (shahtiyya), de l'expression sans filtre (bûhiyya), du lyrisme et de l'esthétisme étaient associés à certains soufis. Mais en fin de compte, leur plus grand dénominateur commun est qu'ils se percevaient comme multiples, alors qu'ils étaient Un. Pour connaître le soufisme, il faut voir "la multiplicité dans l'œil de l'unicité" (al-jam' fî 'ayn al-fard).
L'autre dimension du soufisme est son impact sur les arts et les littératures dans le monde arabe. Nous constatons que la poésie arabe a été étrangement révolutionnée par le soufisme, et les exemples sont innombrables. Le chant (al-inshâd) au sens large, le lyrisme sous toutes ses formes — populaires et non populaires — ont été profondément influencés. En parcourant le monde arabe et islamique, nous découvrirons des trésors musicaux polyphoniques et divins qui proviennent de la source du langage soufi. J'irais même jusqu'à affirmer que de nombreux textes vocaux populaires étaient par nature mélodieux car ils respectaient la rime consonantique ou les rimes utilisant des lettres aériennes comme le Alif ou le Hâ', comme s'ils offraient une musique implicite, facilitant le chant, que ce soit en solo, en duo, en groupe ou en inshâd.
Le Soufisme et l'Essence de la Parole
Nous voyons aussi que, s'agissant de la littérature et de la rhétorique arabes, les soufis ont dynamisé de nombreuses facettes de l'éloquence, de l'écriture et des contraintes stylistiques, allant même jusqu'à la poétisation et la musicalisation de la lettre elle-même. Les exemples sont légion.
J'aimerais me remémorer de nombreux textes que je connais, mais c'est là l'un des effets du soufisme sur la poésie. Il y a aussi son impact majeur sur la prose, allant de la prose rimée (saj') à la prose poétisée (mush'rana), et même à la prose philosophique. Nous avons de nombreux exemples : d'Abû Hayyân At-Tawhîdî à Al-Hallaj dans ses Tawâsîn, en passant par le Bustân al-Ma'rifa, jusqu'à Muhammad Ibn Abd Al-Jabbâr An-Niffarî, auteur des Mukhâtabât, et même Al-Wardî dans Lughat An-Naml (Le Langage des Fourmis).
Vous parlez d'un groupe de personnes littéraires, érudites en langue et ses secrets, en pensée humaine, et en ce qui dépasse les limites du concept philosophique et logique des choses. Abû Yazîd Al-Bistâmî lui-même interpellait les théologiens (al-kalâmiyyûn) de son temps en leur disant : "Quelle est cette science par laquelle vous nous argumentez, ô théologiens ?" — ces derniers étant ceux qui s'étaient lancés dans l'interprétation vers l'herméneutique, s'efforçant d'interpréter le Coran — : "Quelle est cette science par laquelle vous nous argumentez ? Vous l'avez acquise par une trace sur une trace, et d'un mort sur un mort. Quant à nous, notre religion est la Vie qui ne meurt pas."
Cela signifie que, pour le soufi, la science est synonyme de gnose ('irfân). La gnose est la science qui vous parvient par une intuition sur une autre, qui vous arrive inconsciemment plus que consciemment. C'est la science qui dépasse la connaissance au sens logique, démonstratif et rationnel.
C'est pourquoi ils croyaient que la connaissance n'est qu'un seuil dans le voyage vers l'Inconnu, ou dans le voyage vers les nuées. Ceci est une réalité existentielle. Même une grande partie des philosophes matérialistes se sont fortifiés de l'énergie de la métaphysique (mîtâfîzîqâ), afin de prouver que la vraie connaissance réside là, tapie quelque part, au-delà de ce que nous percevons, voyons et entendons.
Le Soufisme : Équilibre et Liberté
Sans l'énergie de l'imagination (al-khayâl), ces grands philosophes n'auraient pas existé, ni ces grandes littératures que nous connaissons, que ce soit dans le soufisme ou dans les méthodes du soufisme.
Le soufisme a eu un impact majeur sur la culture arabe historique d'une part, et un impact significatif sur l'équilibre sociétal d'autre part. La culture soufie est une culture de salut (khalâsiyya). Le soufi n'a rien à perdre, et c'est là l'essentiel. Et parce qu'il n'a rien à perdre, il n'a rien qui l'enrichisse au sens matériel.
Lorsqu'Abû Yazîd Al-Bistâmî était interrogé sur son être : "Qui cherches-tu ?", il répondait : "Abû Yazîd". Il ajoutait : "Moi aussi, je le cherche depuis vingt ans". Il vous dit : "Je ne me connais pas parce que je suis dans un état de fragmentation (taba''ud)". Comme le dit Al-Hallaj :
"Je m'étonne que mon tout soit porté par ma partie, et du poids de ma partie, ma terre ne me porte pas."
Il vous dit : je suis en état de fragmentation, je ne me connais pas, alors comment peux-tu, toi, me connaître, ô homme.
De nombreux exemples résument ces significations universelles. Je n'en citerai qu'un autre, toujours d'Abû Yazîd Al-Bistâmî, qui fut interrogé un jour : "Qu'est-ce qui t'a établi dans la Vérité, ô Abû Yazîd ?"
Il répondit — et il faut méditer sur ses mots — :
"Il m'a élevé une fois entre Ses Mains — ceci est une licence, la Main n'est pas une main —, et Il m'a dit : 'Ô Abû Yazîd, Mes serviteurs aiment te voir.' J'ai dit : 'Orne-moi de Ton Unicité et revêts-moi de Tes Unicités.' Je devins alors un oiseau dont l'aile est faite de la Pérennité (daymûma) et le corps de l'Éternité (abadiyya). J'ai volé dans l'air de la Modalité (kayfiyya) cent mille millions d'années, puis dans l'air de la Causalité (sababiyya) cent mille millions d'années. J'ai regardé, et je n'étais plus celui-là, et Il n'était plus là."
C'est le sommet de l'imagination, mais cela porte des dimensions et des significations immenses. Il vous dit : "Je suis essentiel dans l'énigme, je suis essentiel dans l'Invisible, je suis essentiel dans ce qui est inconnu." Et si je suis ainsi, comment pourrais-je atteindre le lieu de la Vérité ? Et où est la Vérité ? La Vérité est plus grande et plus englobante que ces choses.
Je pense que ces philosophes chargeaient les textes de significations et de dimensions considérables. J'ai de nombreux textes personnels que je ne veux pas répéter, mais ils fournissent les clés pour comprendre ces secrets intimes, sur lesquels nous devons beaucoup méditer pour saisir l'impact de ces hommes sur notre culture historique et sur l'humanité en général. Mais je parle spécifiquement de la culture arabe, cette culture portée par la langue arabe, que je considère comme une mine dont nous n'avons pas encore découvert tous les secrets.
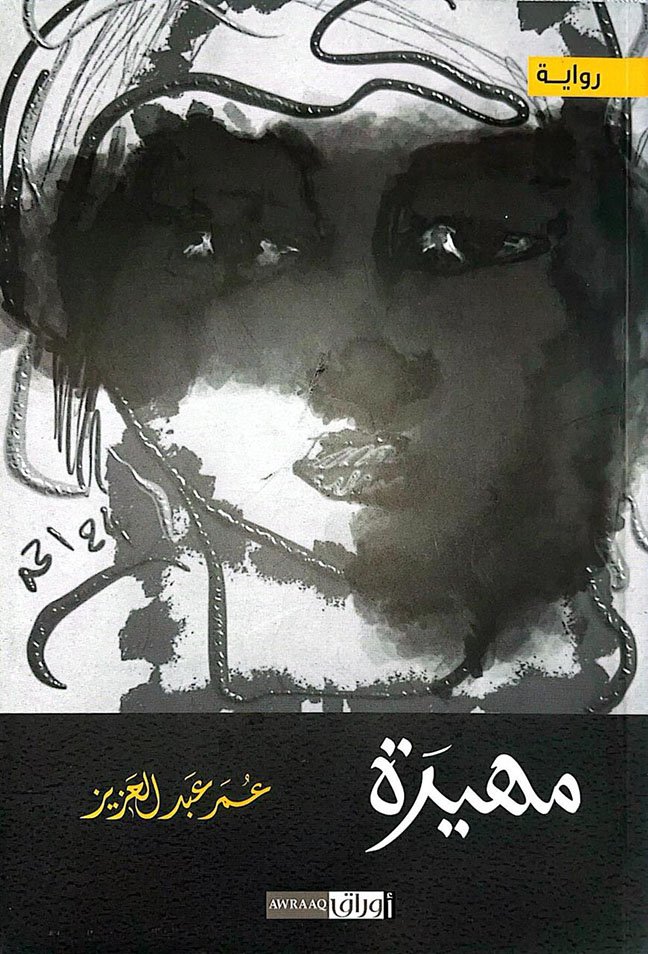
La Métaphysique et le Secret : Ouvrir la Porte de l'Invisible
Vous avez un livre intitulé Le Sultan de l'Invisible (Sultân al-Ghayb), et vos œuvres montrent un intérêt constant pour la métaphysique (al-mawarâ'iyyât). Je m'interroge donc sur la Révélation (al-kashf), l'au-delà de la vérité et l'au-delà du visible. Ce monde magique, cette "mine intellectuelle" que, selon vous, personne ne connaît, quel est le moyen d'y pénétrer ?
Al-Hallaj, dans ses Tawâsîn, a parlé de la Vérité. La Vérité fut le sujet de recherche de presque tous les philosophes, penseurs, soufis, et de tous les êtres humains. Or, il y a la Vérité, et il y a la Vérité de la Vérité — ce qui est insaisissable par le concept. Par conséquent, la recherche de la Vérité est un état d'acharnement, d'épreuve et de labeur incessant (da'b wa mukâbada) qui ne s'arrête jamais. La Vérité est enfouie loin, c'est pourquoi toutes les biographies rapportées dans les littératures soufies, par exemple, recherchaient cette Vérité. C'est le cas du Langage des Oiseaux (Mantiq at-Tayr) de Farîd ad-Dîn 'Attâr, et de la Risâla at-Tayr (Épître des Oiseaux) de l'Imam Al-Ghazâlî.
L'oiseau est le symbole de celui qui migre, qui s'exile, qui traverse les déserts et les solitudes, à la recherche d'un but. La majorité meurt en chemin, et seul l'oiseau élu atteint son but.
La Révélation : Un Marathon Existentiel
La signification symbolique de cette quête est que nous sommes tous engagés dans un marathon existentiel, une course dans laquelle nous sommes prisonniers, courant sans savoir où nous allons. En réalité, la majorité s'écroule en chemin, mais quelques-uns parviennent à destination. Ces arrivants sont peu nombreux, et ils y parviennent par l'énergie de l'âme (rûh), non par l'énergie corporelle ou matérielle. Ceux qui atteignent ce but se rapprochent, dans une certaine mesure, de la Vérité.
Dans les Tawâsîn d'Al-Hallaj, il est question des Tawâsîn de la Vérité. La recherche de la Vérité, comme l'expliquait l'Imam Muhammad Ibn Hâmid Al-Ghazâlî dans une partie de son grand ouvrage Revivification des Sciences de la Religion, traitait de la manière dont les choses inconnues se dévoilent (takashshuf). Il disait, en substance :
"Ne voyez-vous pas que le petit enfant, lorsqu'il voit une lettre et qu'on lui dit que c'est le Hâ', le Bâ', le Tâ', il la voit de ses yeux et l'entend de sa voix ? Puis il voit un mot, on le lui lit, il reconnaît la forme globale du mot, mais pas ses autres abstractions, et il connaît son son. Alors, il s'ouvre à un nouvel horizon : il y a la phrase. On lui explique cette phrase, il la comprend, l'apprend par cœur, et ce troisième Invisible (ghayb) s'ouvre à lui. Ensuite, un Invisible plus grand survient, qui est l'énoncé dans son ensemble, le verset dans son intégralité, ou le dessin dans sa globalité."
Ainsi est le soufi, en état de voyage dans les Invisibles (al-ghuyûb). Ces voyages dans l'Invisible sont une expression concrète du fait que la connaissance n'est ni complète ni absolue ; elle n'existe que de manière partielle et sous forme d'opportunités (mutâhât).
L'Ivresse et la Sobriété : Le Moteur de l'Inconscient
Les soufis croyaient que la vraie science est celle qui dévoile (kashf), la science latente (al-'ilm al-ladunî) qui lève les voiles. C'est ce qui s'applique au verset coranique : "Dis : Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si Nous apportions une mer aussi vaste en renfort."
De même que les versets sur "Dieu est la Lumière des cieux et de la terre" ou "La ressemblance de Sa lumière est comme une niche où se trouve une lampe ; la lampe est dans un verre ; le verre est comme une étoile étincelante, allumée à partir d'un arbre béni."
Les dévoilements (at-takashshufât) sont donc des jaillissements métaphysiques qui accompagnent la vie humaine. Ils se manifestent particulièrement — selon notre terminologie épistémologique moderne — dans les rêves, dans les longues périodes de sommeil, et dans les états de léthargie.
Il en va de même pour le soufi, qui alterne entre les états de sobriété (sahw) et d'ivresse (sukr). Non l'ivresse au sens alcoolique, mais au sens spirituel et naturel du terme. Il vit une oscillation constante entre la grande sobriété et la grande ivresse, ne sachant comment sortir de ce cercle.
L'un d'eux dit : "J'étais dans les deux états, je me réveillais et je m'enivrais." Les soufis croient que ces dévoilements sont des grâces divines qui parviennent à l'homme dans des moments inconscients ou non maîtrisés, ou même face à un danger inattendu. Toutes ces choses activent ce dynamo interne, ce moteur intérieur complet qui ne se met en marche qu'à un certain moment.
Ce moteur émerge de l'Être Existant (al-wujûd al-mawjûd) — un être ontologique, c'est-à-dire un être existant et absent en même temps — qui se reflète dans l'homme et dans son cerveau, mais par le cerveau le plus petit, qui est le cerveau de l'inconscient, correspondant à la RAM (mémoire vive) dans l'ordinateur.
La RAM est un moteur de recherche aléatoire. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui résout le problème du processeur (al-mu'âlij) lorsqu'il est incapable de déchiffrer un code. La RAM est complète et ne fait rien ; elle ne s'active que lorsque le processeur échoue, le mettant alors en mouvement. Ainsi est l'homme : l'inconscient (al-lâshu'ûr) est le moteur fondamental de l'être humain.
Ces questions furent comprises par les soufis qui en ont écrit avec une grande générosité. Je rappelle à cette occasion le livre de l'Imam Muhammad Hâmid Al-Ghazâlî intitulé L'Alchimie du Bonheur (Kîmiyâ' as-Sa'âda), où il aborde la nature de l'être humain, ses pertes, et comment cet homme peut se maîtriser, et maîtriser l'environnement sans manifester la moindre forme de la force habituelle, qui est la domination matérielle traditionnelle.
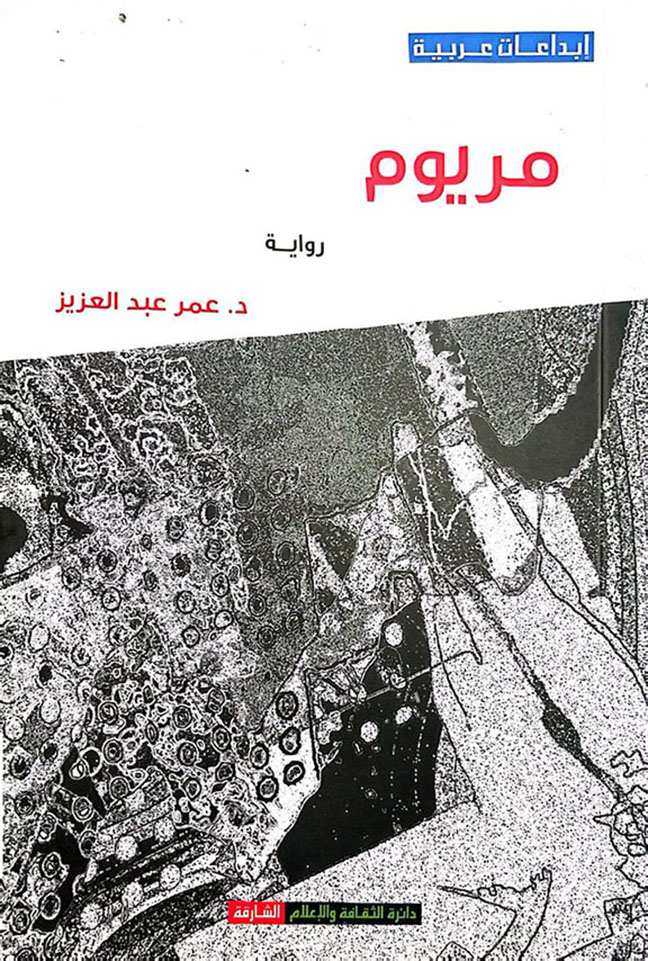
Le Débat Philosophique : Relativité des Origines et Pensée Arabe
Pendant de longues années, la philosophie a souffert dans notre culture arabe d'une incompréhension et d'un manque de connaissance, alors qu'elle est une mer et une science humaine essentielle. Après un long débat, un terme conciliateur a émergé : la "philosophie islamique". Quel est votre avis sur cette controverse ? Et quelle est la véritable place de la philosophie dans la culture arabe ?
L'histoire a tendance à attribuer la philosophie aux Grecs, mais cette attribution ne saurait être acceptée dans sa totalité. Il existait des philosophies humaines enfouies dans la profondeur asiatique, dans la profondeur africaine, et dans le monde entier. En d'autres termes, c'est l'Existence qui détermine l'essence de la philosophie. L'Existence est synonyme de confrontation à l'Inconnu, de phobie (peur pathologique), d'incapacité à expliquer, et d'approche graduelle des états de l'être.
Pensons à l'histoire d'Abraham (le Prophète Ibrâhîm, paix soit sur lui) qui observa la lune, puis le soleil, pour aboutir à l'abstraction suprême qu'il y a un Dieu au-delà de toutes ces choses éphémères.
Par conséquent, la philosophie est, à la base, synonyme de l'existence humaine elle-même. L'être humain est intrinsèquement lié à la question, à la recherche, à l'incapacité d'expliquer, à la peur, à la joie, et à de nombreux facteurs. Toutes ces réalités ont engendré chez lui ce que l'on pourrait appeler la question sans réponse. Or, la question sans réponse est une question philosophique, c'est-à-dire une question métaphysique, imaginaire.
Une Dette Historique et Géographique
Toutefois, en dehors de ce cadre existentiel, si nous nous arrêtons sur l'écriture historique qui nous concerne, nous, les Arabes, nous avons été profondément influencés par Aristote, notamment après les traductions et les recherches approfondies qui ont été menées, en particulier par Ibn Rochd (Averroès). Nous avons également été influencés par l'aristotélisme grec ancien, qui avait lui-même été marqué par la philosophie égyptienne antique, un point très important.
Nous n'étions donc pas éloignés de la philosophie asiatique. La preuve en est que Bagdad était, à l'époque, le pont relationnel reliant l'Orient et l'Occident, tout comme l'Égypte était le pont entre la Méditerranée septentrionale (nordique) et la Méditerranée méridionale. L'enjeu était la transformation au sein de cet espace, celui de la grande interactivité humaine.
Dans ce domaine, les Arabes se sont historiquement positionnés en Afrique du Nord, dans la péninsule Ibérique, dans diverses îles de la mer Méditerranée, au Levant, et bien sûr dans la péninsule Arabique. Mais l'arabité au sens large, au sens anthropologique, existait au-delà des limites géographiques que nous appelons aujourd'hui la Ligue Arabe.
La Ligue Arabe n'exprime pas la véritable essence de l'anthropologie arabe traditionnelle, car la langue arabe est présente au Tchad, en Érythrée, en Tanzanie, au Congo, au Mali, etc., et de même en Asie. En d'autres termes, la carte linguistique arabe est beaucoup plus vaste que celle de la Ligue Arabe. Cette carte linguistique arabe est ancrée dans la religion, dans le soufisme et dans le comportement ; elle n'est pas une simple couche superficielle, mais une partie du tissu culturel de ces régions.
Ibn Rochd et Al-Ghazâlî : Clarification d'une Querelle
Telle était donc la philosophie. Si nous abordons le sujet sous l'angle historique, nous devons nous arrêter aux figures d'Ibn Rochd et de Muhammad Ibn Hâmid Al-Ghazâlî. À propos, certains comprennent mal le rejet de la philosophie par Al-Ghazâlî. Al-Ghazâlî n'a pas rejeté la philosophie, il a rejeté les philosophes. Son livre s'intitule L'Incohérence des Philosophes (Tahâfut al-Falâsifa), et non pas L'Incohérence de la Philosophie. Il visait les philosophes avec lesquels il était en désaccord sur le fond de leur argumentation, ce qui est légitime en tout temps. Mais il ne parlait pas de la philosophie en mal, car il était lui-même un grand philosophe, un homme de questions, et un chercheur infatigable. Il suffit de rappeler qu'il a écrit L'Alchimie du Bonheur et L'Épître des Oiseaux.
Ibn Rochd fut un tournant majeur dans l'internalisation complète des cultures grecque ancienne et hellénistique-romaine postérieure, ainsi que de la culture religieuse qui les accompagnait. Un débat byzantin existait alors sur la relation entre la Vérité (qui signifiait la philosophie) et la Loi (ach-charî'a, la religion). Il écrivit Le Traité décisif (Fasl al-Maqâl) sur la concordance entre la Loi et la Sagesse. Il réalisa un acte cognitif révolutionnaire en affirmant que la Loi et la Vérité ne se contredisent pas, mais convergent vers le seuil de la Vertu. C'est si la Vertu n'est pas leur but commun qu'une contradiction apparaît.
Par cette maxime, Ibn Rochd a préparé le terrain à la philosophie du siècle des Lumières en Europe, ouvrant la voie à la philosophie de la grande Réforme. C'est l'une des merveilles de l'histoire que la culture humaine en Europe était alors liée à la langue arabe. À l'époque, il n'y avait pas d'intellectuel, pas de prêtre, pas de rabbin qui n'écrivait et ne maîtrisait pas l'arabe. Plus tôt encore, le philosophe Al-Kindî fut une étape très importante, car il apporta une contribution considérable et eut une grande présence dans ce domaine.
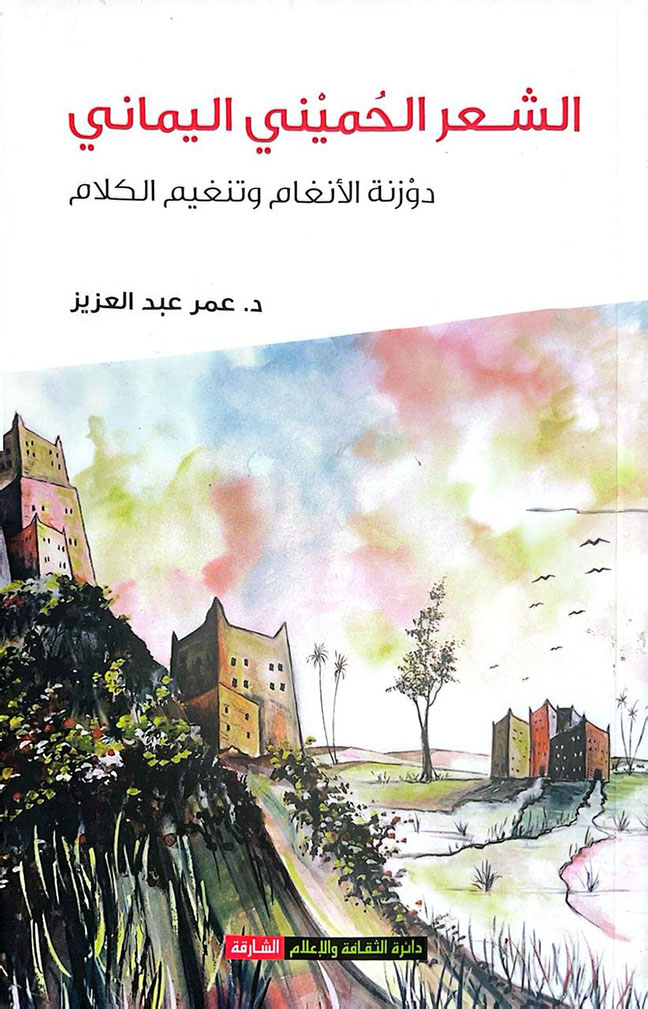
La Méfiance Envers l'Autre : Mémoire Humaine et Nécessité du Contradictoire
La relation de l'homme arabe à l'Autre est ambigüe. Bien que la religion incite à la connaissance mutuelle, il existe une méfiance envers l'Autre dont j'ignore la cause, peut-être enracinée dans l'histoire. Quels sont les motifs de cette méfiance, et comment résoudre cette problématique dans le monde nouveau ?
Cette question concerne la mémoire humaine et de nombreuses traditions mondiales, qu'elles soient liées à des dogmes, des idéologies, ou ce que l'on pourrait nommer des "modèles utopiques hypothétiques", ou bien qu'elles soient associées aux différentes religions. Il nous faut donc distinguer l'interprétation des religions, leurs herméneutiques (ta'wîlât), et les coutumes qui naissent en marge des religions, de leur essence profonde.
Nous abordons également la vision et la pensée à travers le prisme de l'idéologie, que nous considérons comme une rupture cognitive et procédurale avec l'opinion et la pensée d'autrui. L'idéologie, par nature, essaie de se présenter comme la seule vision complète, exhaustive et définitive. Or, la vérité objective indique que les réalités, dans la vie, sont dispersées en une immense variété et multiplicité.
L'Autre est une Nécessité Absolue
Par conséquent, si nous voulons parler de l'Autre au sens conceptuel, nous devons comprendre que cet Autre est, dans un certain sens, "Moi". Le Moi (al-anâ) n'a aucun sens sans l'Autre, car c'est cet Autre qui vient soit confirmer la validité de mes visions, soit me critiquer. Dès lors, cette critique positive devient la raison pour laquelle je reproduis ma connaissance et mes visions de manière plus saine.
C'est pourquoi cet Autre est une nécessité absolue au sens philosophique. L'Autre est le Contraire (an-naqîd), et nous savons que la Contradiction (at-tanâqud) est une loi absolue de la Nature. La contradiction est le synonyme des dualités et des transformations. En d'autres termes, tout phénomène dans la Nature et dans la vie porte deux visages : le plus et le moins en arithmétique, le proton et l'électron dans l'atome, la différentiation et l'intégration en algèbre, ou les charges positive et négative en électricité.
Par conséquent, la loi de la contradiction est une loi générale. Mais cette contradiction, que nous percevons dans le cadre de dualités opposées, se dissout en une multiplicité et se transforme. Nous devons donc reconnaître que, dans notre interaction avec l'Autre humain, quel qu'il soit, nous sommes en train de nous transformer mutuellement. L'influence est réciproque. J'irais même jusqu'à affirmer que la théorie selon laquelle le vainqueur imite le vaincu est vraie au sens khaldounien (en référence à Ibn Khaldoun), bien qu'elle soit relative. Le vainqueur, qui s'imagine avoir surpassé l'autre culture parce qu'il est plus fort et plus englobant, oublie totalement qu'il s'abreuve chez cet Autre "plus petit" d'éléments et de charmes très importants pour sa propre culture.
L'Altérité Noble et la Dialectique de l'Existence
C'est pourquoi nous ne pouvons en aucun cas affirmer que la victoire est absolue, que la contradiction est absolue, ou que l'interactivité entre les visions, civilisations et cultures humaines repose sur le principe du conflit absolu.
Le conflit porte en lui le règlement, et il porte le non-conflit. La croissance porte en elle la disparition et la transformation. C'est précisément sous cet angle que nous devons adopter la culture de l'Autre, sur la base du fait que cet Autre est une nécessité. C'est pourquoi, pour moi, les Autres (al-aghyâr) sont une nécessité absolue. Cet Autre est celui qui confirme ma justesse (si j'ai raison), ou me critique (si j'ai tort).
Je nomme cela l'"Altérité Noble" (al-ghayriyya an-nabîla). C'est celle qui accepte la non-hostilité absolue et la non-rupture absolue. Cette hostilité et cette rupture n'ont aucun lien avec les réalités de l'existence d'une part. D'autre part, le conflit, s'il existe, est une loi historique objective qui a toujours existé et existera toujours au sein de la culture humaine.
Nous devons donc intégrer cette vérité : il existe deux dimensions de la vie que l'histoire confirme et généralise comme des vérités existentielles irréductibles. Ce sont la dimension du conflit et celle de l'harmonie et de la concordance en même temps. C'est l'équation absolue qui régit les réalités existentielles de la vie, tout comme elle régit les visions métaphysiques. Ces dernières doivent être une continuation de ce qui se passe dans les réalités existentielles. Autrement dit, c'est l'Existence qui crée les charmes magiques de ce que l'on pourrait appeler l'Après-Existence, c'est-à-dire la Conscience La Conscience.
Ceci est ma conception de la contradiction entre les idées et avec l'Autre humain.
Si nous nous engageons dans un conflit acharné avec l'Autre humain, nous nous engageons tout simplement dans un conflit avec nous-mêmes. Si nous faisons la paix avec nous-mêmes, nous faisons la paix avec l'Autre. C'est là l'espace magique entre la concordance, l'harmonie, et l'opposition. Ces deux dimensions sont nécessaires l'une autant que l'autre, tout comme l'harmonie et l'opposition. C'est exactement comme l'exécution symphonique : sans harmonie, la mélodie musicale ne tient pas, et sans contrepoint (contrepoint), la valeur expressive de cette structure mélodique n'est pas assurée. Telle est la vérité.
C'est pourquoi nous voyons que les instruments à percussion s'imbriquent avec les instruments à cordes, même s'ils ont un rôle différent. Et nous voyons que les instruments à vent s'imbriquent avec les instruments à percussion. Telle est la vérité.
Nous sommes une continuité d'Abel et Caïn d'une part, jusqu'à Schopenhauer et Nietzsche et d'autres théoriciens de la violence dans le monde, et nous sommes aussi une continuité de la grande tolérance depuis Jésus (paix soit sur lui) et pour l'éternité. Telle est la vérité.
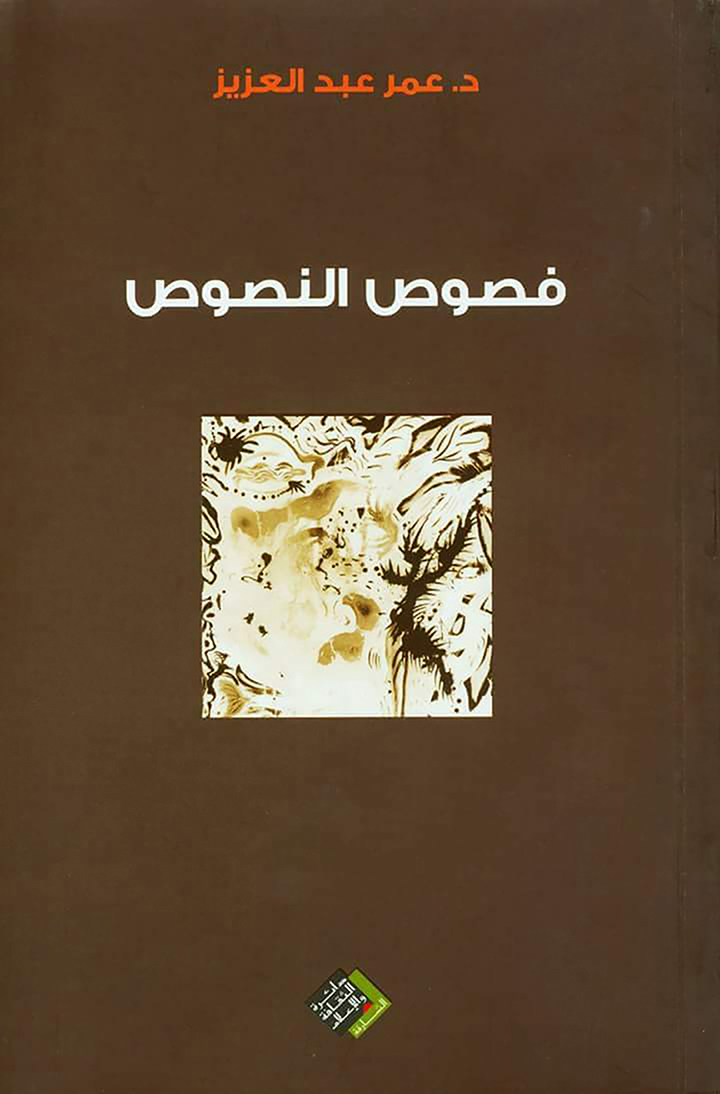
Le Brassage des Civilisations : Définition et Sources de la Culture Arabe
La civilisation est la résultante du brassage entre différentes cultures. Concernant la culture arabe, quelles sont les caractéristiques de son influence et de son impact sur les autres cultures ?
Tout d'abord, la culture ne peut être définie de manière procédurale ni de manière typique (namatiyya). Si nous tentons de la cerner en nous basant sur les fantasmes (istîhâmât) présents dans l'esprit des intellectuels et des penseurs, nous la réduirons à la simple reproduction matérielle et spirituelle par l'intelligentsia ou les élites. Or, en réalité, tout le monde participe à la culture.
La culture, dans son sens large, inclut quiconque reproduit les biens matériels et spirituels au sein de la société humaine, et tous contribuent à l'essor de la civilisation.
L'Inclusivité des Arts et de la Littérature
C'est pourquoi, lorsque nous nous penchons, par exemple, sur n'importe quelle branche de la culture, comme la littérature ou les arts, nous trouvons des arts qui sont attribués aux élites artistiques qui appartiennent à la culture savante (thakâfa al-'âlima), et à la pratique professionnelle minutieuse et artisanale. Mais la culture englobe également les arts appliqués et les arts populaires avec toutes leurs nuances ornementales et décoratives.
Par conséquent, nous ne pouvons pas circonscrire l'art au seul art classique ou au seul art romantique ; il inclut de très nombreuses choses, y compris les arts vernaculaires simples.
Il en va de même pour la littérature. Nous ne pouvons pas parler de la seule littérature écrite en arabe. Par exemple, nous ne pouvons pas dire que la littérature arabe n'inclut que la poésie arabe pré-islamique (dite jâhilî), la poésie des débuts de l'Islam, puis celle des périodes Omeyyade, Abbasside, Andalouse, et ainsi de suite. Bien que ces classifications existent, la poésie doit inévitablement s'ouvrir aux textes vernaculaires (al-nussûs al-'âmmiyya), quels qu'ils soient, depuis l'époque abbasside jusqu'à nos jours. De nombreux textes vernaculaires ont constitué un affluent majeur de la littérature ou de la poésie arabe.
La Double Source de la Créativité
Ce que je veux dire, en bref, c'est que la culture ne peut jamais être encapsulée par une définition typique, procédurale, ni par une définition sélective ou arbitraire de l'une de ses formes. Elle est globale. Le caractère global de la culture signifie précisément que chacun peut y contribuer de diverses manières et mesures. Cependant, la contribution des gens est relative.
Certains contribuent à la culture par la connaissance savante (al-ma'rifa al-'âlima), au sens scolaire : celle qui est acquise de livre en livre, et de professeur en professeur. D'autres ajoutent à cette réalité académique et objective le talent (al-mawhiba). Le talent est relatif, il est une grâce divine (minan ilâhiyya). Ce talent permet au poète de se distinguer des autres, même s'il n'a pas lu ou étudié autant qu'eux, ou s'il n'est pas diplômé d'une faculté littéraire spécialisée.
Ainsi, lorsque nous parlons de la créativité dans la culture, nous devons intégrer le fait qu'il y a deux dimensions à cette créativité :
La dimension qui se produit par transmission (tawâtur) : d'enseignement à enseignement, de cahier à cahier, et de livre à livre.
La dimension qui vous parvient sans que vous ne vous y attendiez.
C'est pourquoi Al-Hallaj disait : "La science est de deux types : innée (matbû') et acquise (muktasab). Et la mer est de deux types : celle que l'on chevauche (markûb) et celle que l'on craint (marhûb)." Il entend par la science innée cette science latente (al-'ilm al-ladunî), celle qui vous vient à l'improviste. Nous l'appelons talent, révélation, vision, inspiration – nommez-la comme vous voulez. Quant à la science acquise, c'est celle qui vous vient par une trace sur une trace, un livre sur un livre, un maître sur un maître, et un mort sur un mort. Il est essentiel de comprendre cela pour saisir la signification de la créativité dans la culture. La créativité culturelle ne peut être encapsulée épistémologiquement ; elle n'est pas une affaire purement scientifique.
Nous avons discuté de la définition de la culture, et j'affirme que nous avons besoin de la définition de la définition elle-même, car nous nous heurterons à de nombreuses définitions de la culture, et chaque définition nécessitera une autre définition. Nous sommes donc dans une progression croissante de définitions infinies qui, en fin de compte, doivent être spécifiées comme suit : la culture est cette donnée cognitive, esthétique, coutumière, sociale, psychologique et parapsychologique qui éclot et jaillit de l'esprit des humains et de leurs compétences découlant de ces esprits.

La Prose Artistique : Pourquoi cet Oubli ?
Si l'on considère les arts de l'expression littéraire, on trouve la poésie, la nouvelle, le roman. Mais certains arts ont été délaissés, parmi lesquels la prose artistique (an-nathr al-fannî), tombée dans l'oubli malgré son histoire et ses pionniers. Pourquoi les outils de la critique arabe ont-ils ignoré cet art majeur ?
Cette question est d'une importance capitale pour deux raisons. La première concerne la classification et la caractérisation des arts et des lettres dans la culture arabe. Il est de coutume dans la culture arabe de considérer la littérature comme séparée des arts (al-funûn). Les Arabes étant une nation d'éloquence (bayân), de langue et de poésie, c'est l'expression poétique et linguistique qui a été la plus dominante et la plus historique. C'est pourquoi la littérature a été séparée des autres formes d'art dans le monde arabe.
Or, les programmes qui soutiennent la littérature sont les mêmes que ceux qui soutiennent les arts. En d'autres termes, si nous prenons les critères de la littérature, nous constatons qu'ils sont identiques aux critères des arts visuels, du cinéma, du théâtre, de la musique, etc. Par conséquent, la classification établie dans le monde arabe repose sur une séparation procédurale entre la littérature et les autres arts.
Cependant, cette séparation n'existe pas dans la culture européenne, par exemple, où les arts se ramifient en littérature, et où la littérature se ramifie en poésie, en narration (sard), et ainsi de suite.
Nous devons donc souligner la spécificité de la classification arabe qui sépare la littérature des autres arts. Mais cette séparation procédurale a conduit à un éloignement de la littérature par rapport aux autres arts, c'est-à-dire un éloignement des critères de perception de l'essence de la littérature, de l'essence des arts visuels, de l'essence de la musique et de l'essence de la poésie. Ce n'est pas une vérité factuelle, car il existe une correspondance et une intertextualité (tanâss) entre tous ces arts.
L'Unité des Arts : La Musique dans la Langue
Ceci nous amène à parler de la prose dans la culture arabe. Depuis Al-Jurjânî, Al-Jâhiz, les linguistes, les grammairiens, et Abû al-Aswad ad-Du'alî, il y avait une véritable conscience que la littérature et la langue n'étaient pas séparées des lois des autres arts.
La preuve en est qu'Al-Khalîl Ibn Ahmad Al-Farâhîdî (fondateur de la métrique arabe) définissait la musique de la poésie arabe à travers la musique elle-même. La preuve est également que Al-Jâhiz, Al-Jurjânî et Ibn Jinnî, entre autres, définissaient la littérature et la langue comme une expression confirmée de l'accord (dawzana) ou de la musique.
Il existait donc une vision établie depuis l'Antiquité. Même le Saint Coran est une preuve absolue et décisive de l'importance et de l'essence de ce que l'on pourrait appeler la prose poétisée (an-nathr al-musha'ran), ou la prose rythmée, ou la prose qui porte des énergies expressives et esthétiques, ainsi que des énergies sémantiques très diverses et multiples.
Le fait que les Arabes étaient une nation de poésie a fait qu'ils ont été stupéfaits par le Coran, après y avoir trouvé une éloquence et une rhétorique extraordinaires, comparées aux genres littéraires qu'ils pratiquaient, y compris la poésie, la prose rimée (saj') et la prose artistique. Nous savons en effet que les Arabes, depuis l'époque pré-islamique, étaient une nation d'éloquence et de discours en prose.
La Richesse du Lexique : Les Secrets du Mot Arabe
Nous restons sur le sujet de la langue. J'aimerais soulever la question du lexique. Dans l'histoire littéraire, la langue est incroyablement riche en noms pour les choses. Il y a quelques jours, je lisais un livre patrimonial, Al-Bi'r (Le Puits), et j'ai été surpris d'y trouver 72 noms pour le puits, ce qui témoigne de la richesse de la langue et de la culture du poète. Pourquoi ces noms ont-ils disparu aujourd'hui ? Et comment pouvons-nous tirer profit de ce trésor historique de terminologie à l'ère actuelle ?
Il est incontestable que les Arabes représentaient le centre du monde en matière de civilisation, de développement et de culture dans les siècles passés. Il est également incontestable que nous sommes aujourd'hui dans une période de déclin (inhisâr). Or, la nation qui se relève est celle qui crée une culture globale. Pendant des siècles, les Arabes ont constitué la référence suprême pour l'ensemble de l'Europe, au point que les grands savants et les grands théologiens européens parlaient et écrivaient en arabe. Celui qui ne connaissait pas l'arabe n'était pas considéré comme un érudit.
Ceci indique clairement que nous avons ensemencé l'Europe avec des éléments culturels, artistiques et littéraires majeurs. Les Européens tentent aujourd'hui d'attribuer tous ces germes laissés par les Arabes à la culture grecque, ce qui n'est pas tout à fait exact.
Certes, les Arabes ont traduit Aristote et diverses littératures grecques, et les ont transmises à l'Europe, mais les éléments germinatifs provenant de la culture arabo-islamique étaient considérables. En témoignent de nombreux arts qui ont prospéré en Europe, comme le Baroque et le Rococo, ainsi que la musique orchestrale. Tous ces éléments, dont je n'entrerai pas dans les détails ici car ils nécessiteraient des livres entiers, indiquent que l'impact arabe en Europe était certes un héritage grec — nous ne disons pas le contraire —, mais cet héritage grec n'était qu'une composante, un affluent modeste des vastes apports culturels arabes sur l'ensemble de la culture européenne, qui se sont reflétés dans la linguistique, la musique, l'architecture, la langue, la littérature et les diverses sciences.

Le Transfert du Centre de Gravité Culturel
Nous affirmons donc que cela fut une phase. Puis, un repli s'est produit dans le monde arabe. Cette réalité historique est un centre de gravité qui, tout au long de l'histoire humaine documentée, se déplace constamment d'un lieu à un autre. Le centre de gravité civilisationnel s'est déplacé vers l'Europe, et il est peut-être en train de se diriger vers l'Asie aujourd'hui.
En d'autres termes, le centre de gravité est ce qui équilibre la présence de l'humanité dans ces cultures et civilisations. De même que le centre de gravité dans un avion bouge de gauche à droite, d'avant en arrière, et que c'est ce centre physique invisible qui permet à l'avion de voler, de décoller et d'atterrir correctement — si ce centre se dérègle, l'avion entier se dérègle. C'est la loi des civilisations : elles se déplacent de pays en pays, d'une géographie à une autre. C'est ce qui nous est arrivé dans le monde arabe : la capitale mondiale est passée de Bagdad, de Damas, de Fustat (Le Caire) à d'autres lieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la civilisation contemporaine.
Ce centre se déplacera vers d'autres endroits, et Dieu provoquera les causes de ce phénomène. Nous, dans le monde arabe, devons reconnaître que nous avons connu un recul radical.
Le Secret des Synonymes : La Dualité de la Racines
Cependant, les germes sont restés. Les germes de la civilisation humaine sont semblables aux graines des plantes : il est prouvé qu'il existe des graines qui ont survécu des milliers d'années et peuvent encore germer. La vie y est tapie jusqu'à la fin des temps. En d'autres termes, les graines de l'ère pharaonique sont conservées dans des jarres iconiques quelque part et germent encore aujourd'hui. Ceci affirme qu'aucune chose ne meurt, qu'aucune civilisation ne meurt.
Mais lorsque nous parlons de la langue arabe, nous devons savoir que cette langue porte dans ses plis, ses profondeurs et ses subtilités des éléments civilisationnels majeurs. Ces éléments doivent être découverts pour comprendre le sens profond des synonymes (al-mutarâdifât) en arabe.
Les synonymes en arabe ne sont pas un simple remplacement d'un sens par un autre, mais une multiplicité de significations au sein d'une seule et même chose. On peut nommer le lion de plusieurs noms, ou le puits de plusieurs noms, mais chacun de ces noms pour le lion possède, dans chaque situation, une connotation spécifique. Le Layth n'est pas le Ghadanfar, qui n'est pas l' Asad, et ainsi de suite.
Par conséquent, les synonymes sont des ombres de connotations sémantiques et de caractérisations complètement différentes d'un simple substitut. C'est une propriété dérivationnelle étrange et magnifique de cette langue. C'est pourquoi la racine linguistique dans le monde arabe repose sur une trilittéralité. Mais cette structure trilittérale ne renvoie pas seulement à plusieurs significations dérivées de la racine ; elle renvoie à plusieurs dimensions dans le son et à plusieurs dimensions dans la connotation à travers la même racine. Par exemple, le mot jamal (chameau) renvoie à une série de significations dérivées des trois lettres, et chaque lettre porte en elle-même une signification spécifique.
Je crois que ces éléments civilisationnels historiques ne disparaissent pas. Même s'ils se sont estompés, ils doivent se reproduire, car l'humanité a besoin de revenir au passé pour découvrir, dans ses archives, cette belle langue culturelle et civilisationnelle qui est encore vivante en elle.
Les exemples sont très nombreux. Et ici, je ne parle pas en tant que défenseur de la seule culture arabe ; j'estime que toutes les cultures humaines contiennent ce sens, d'une manière ou d'une autre. Même si elles se sont estompées ou semblent avoir voyagé vers un autre lieu, il doit venir un jour où elles reviendront pleinement, tout comme le fit la pierre de Rosette pour la civilisation pharaonique et égyptienne antique, dont la découverte a révélé un document résumant toute une histoire.
L'Intelligence Artificielle : Imitation Cérébrale et Renaissance du «Naturel»
Nous avons évoqué il y a un instant l'Intelligence Artificielle (IA) et ses dangers pour la littérature. Cela m'amène à une question importante, celle de l'«Inné» (at-tab') et de l'«Artifice» (as-sun'a), un débat qui a préoccupé les critiques depuis des siècles. Ne pensez-vous pas que nous ayons besoin de ressusciter l'idée de l'Inné dans la création littéraire ? Comment asseoir cette valeur ?
Nous devons reconnaître une réalité unique, à la fois objective, scientifique et historique. Cette réalité nous indique que toutes les industries mécaniques et électroniques qui ont vu le jour au cours des deux ou trois derniers siècles découlent de la Création Divine, du codage structurel propre aux êtres vivants. L'avion est inspiré des oiseaux, l'automobile des quadrupèdes, et les éléments moteurs de ces véhicules utilisent les mêmes principes physiques que ceux que l'on trouve chez les organismes vivants. C'est le premier point.
L'évolution a mené à une tentative d'imiter le cerveau humain à travers la cybernétique ou la science des matrices mathématiques. Cette discipline traite les données formelles, calculées et écrites par un traitement électronique, c'est-à-dire qu'elle les convertit en matrices. Ce type de science existait déjà dans l'Antiquité, mais il était dissimulé dans des archives obscures.
En dernière analyse, toute la science informatique repose sur la tentative de simuler le cerveau humain. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase de cette simulation : l'Intelligence Artificielle, dont l'objectif est de créer une immense mémoire pour le traitement, le stockage et la reproduction.
Le Cerveau Humain, Au-delà de l'Imitation
L'IA est alimentée par des milliards de données, de concepts et d'informations, qu'elle reproduit. Mais si l'on compare le cerveau humain aux ordinateurs modernes et quantiques — le summum de ce que l'humanité a réalisé jusqu'à présent —, on constate qu'il n'y a aucune commune mesure entre le cerveau et ces machines.
Le cerveau humain contient des milliards de cellules qui ne sont pas seulement des points actifs, mais qui alternent des signaux des milliers de milliards de fois. Le cerveau humain est impossible à égaler ; c'est exclu par tous les critères.
Ce qui se passe, c'est que les concepteurs ont tenté d'opérer des glissements dans l'IA vers la problématique des formes de la logique aristotélicienne, comme l'a fait le groupe chinois DeepSeek. Les Chinois ont été intelligents dans cette approche, parvenant à ce type de "logification" grâce à un apprentissage massif (comparé à ChatGPT ou Gemini, par exemple). Ils ont ainsi atteint une forme de logique formelle pythagoricienne-aristotélicienne, mais cela reste très limité par rapport au cerveau humain.
L'IA pose aujourd'hui de nouveaux défis : toutes les tâches mécaniques, répétitives et quantifiables seront exécutées beaucoup plus rapidement par la machine. Il y aura une friction implicite avec les formes de la logique formelle et mathématique. Cela ouvre la voie à des créations dans les machines, les ordinateurs et les robots que l'humain ne peut réaliser facilement. Cependant, en fin de compte, toutes les machines sont inspirées de l'humain, y compris leur structure physique, le Hardware.
Nous parlons donc ici de hardware ou d'organes fonctionnels nouveaux et sophistiqués qui imitent l'homme et les animaux, mais qui ne possèdent pas, dans un avenir proche ou prévisible, l'imagination, l'intuition, le sentiment, ni la créativité au sens d'une autonomie absolue et sans rétroaction.

L'IA comme Stimulus de la "Flamme Éteinte"
Certaines personnes se laissent fasciner par l'IA, car elle simplifie l'écriture d'une nouvelle. Laissez-la écrire une histoire via ChatGPT : elle le fera, en se basant sur votre vocabulaire ou vos éléments fondamentaux. Elle créera une œuvre d'art visuel selon vos instructions. Mais en dernière analyse, ces créations manquent d'âme. Ce sont des manifestations purement déclaratives et phénoménologiques ; elles ne peuvent en aucun cas remplacer l'être humain.
Au contraire, l'IA stimule des éléments dans le cerveau humain qui étaient en sommeil ou éteints. Dans le contexte du développement historique, certains éléments du hardware physique sont activés ou désactivés, tout comme des éléments du software.
Prenons un seul exemple : la culture orale va s'épanouir sous l'IA. Cette culture, qui s'est considérablement éteinte, va retrouver sa gloire. Elle est latente dans un certain centre du cerveau. Ce centre, qui recèle l'essence de la culture orale, ressurgira grâce à l'Intelligence Artificielle.
L'IA va stimuler de nombreux éléments. Considérez l'écriture à la main : c'était une forme de solo musical. Le musicien soliste nuance la musique, et l'écrivain nuance l'écriture avec son stylo traditionnel, modifiant les inclinaisons de sa plume (surtout pour la calligraphie arabe). Avec le clavier ou l'imprimante, tous les doigts travaillent ensemble. Le cerveau s'aligne sur cette nouvelle situation : il mémorise parfaitement les emplacements de transfert, comme un musicien, et utilise tous ses doigts, non plus la seule main pour la plume.
Ainsi, de nouveaux éléments émergent. Autre exemple : les voitures. Changer manuellement les vitesses était une forme de musique, une sensation de la différence entre la première, la deuxième, la troisième vitesse, etc. L'humain utilise désormais des voitures automatiques. Cela doit nécessairement modifier sa logique de conduite et sa perception de la musique de la voiture.
La musique se cachera derrière de fines couches de transparence. Ainsi, toute science et toute évolution stimulent certains éléments chez l'homme, tout en en inhibant d'autres dans son cerveau.
L'Intelligence Humaine : La Pointe de l'Iceberg
Je crois que le problème n'est pas le développement de l'Intelligence Artificielle, mais le déclin de l'intelligence humaine. Une étude que j'ai lue hier dans Forbes le confirme. Quel est votre avis ?
Premièrement, nous devons savoir que nous n'utilisons de ce cerveau que l'extrémité d'un iceberg. Ce que nous utilisons des capacités du cerveau humain est insignifiant par rapport aux potentialités latentes. La réserve non utilisée est l'iceberg que nous ne voyons pas, et ce que nous utilisons n'est que la tête du sommet, une infime partie.
Deuxièmement, tout changement dans la vie naturelle modifie les centres du cerveau. Le cerveau humain est une station stratégique de latences et de réserves illimitées, toutes utilisables à un moment donné. Nous voyons avec nos yeux, par exemple, mais ce cerveau peut nous faire voir ce que nous ne voyons pas, sentir ce que nous ne sentons pas, entendre ce que nous n'entendons pas.
Le cerveau humain est semblable à un océan vaste et profond. Ce que nous voyons et utilisons de ce cerveau, ce sont les vagues qui se brisent sur le rivage, les conclusions de l'affaire. Nous ne pouvons pas imaginer un tsunami venant de cette mer, balayant toute la terre ferme, comme ce fut le cas lors du déluge de Noé (paix soit sur lui).
Si nous considérons le cerveau humain et ses capacités immenses et illimitées, nous découvrirons que nous ne sommes que de simples poissons côtiers nous nourrissant des restes de ce cerveau. Or, ce cerveau est dans un état de défi constant. Tout changement l'affecte positivement et négativement. Négativement, en ce que certaines zones du cerveau s'éteignent, comme cela s'est produit pour la culture orale à cause de l'essor de la culture de l'écriture. L'écriture a fait que les gens ne mémorisent plus, alors qu'avant ils le faisaient. Mais cette capacité perdue est toujours latente et tapie ; elle peut ressurgir à nouveau sous l'effet de défis et de changements de ce type.
Par conséquent, nous ne pouvons comparer le concept d'Intellect/Raison (Al-'Aql) et le concept de Cerveau (Ad-Dimâgh). L'Intellect, selon la définition académique et procédurale courante, est lié à la logique formelle, à la logique algébrique et à la logique apparente. Autrement dit : un plus un égale deux, logiquement. Mais les lois de l'Existence ne sont pas ainsi ; elles dépassent totalement cette question. C'est pourquoi le Cheikh Muhyi ad-Dîn Ibn 'Arabî disait : "Ce poète qui m'a précédé et m'a lapidé avec les pierres de sa raison a menti", comparant la logique purement rationnelle à des pierres.
Ces gens qui vivaient dans le désert, c'est la Nature qui leur a tout appris. L'Intellect est relatif, il n'est qu'une partie de la vérité. L'Intellect, au sens cognitif du terme, est lié à ce qui est apparent dans la connaissance. Mais après l'Intellect, il y a la Connaissance .
La Musique de l'Art : L'Harmonie Cachée de l'Existence
La musique est un art en soi, mais c'est aussi un élément fondamental de tout art. Je prends l'exemple de la musique de la poésie : les critiques la limitent au poids (al-wazn) et à la rime (al-qâfiya), et mentionnent parfois timidement la musique interne. Mais la question est beaucoup plus profonde. Quel est votre avis sur la musique cachée, invisible, et son rôle dans le processus créatif ?
Tout dans l'Existence est mis en musique (mûsmâq), tout est accordé (mudawzan). La balance générale qui régit cette existence humaine est fondée sur la musique. Par conséquent, si vous méditez sur cette question, vous découvrirez que tous les principes régulateurs (an-nawâdhim) portés par la musique sont présents dans tous les autres éléments, qu'il s'agisse des régulateurs des mathématiques ou de ceux des couleurs. Ce programme peut être appelé la Musique de l'Existence, la Lettre de l'Existence, ou le Chiffre de l'Existence.
La preuve en est que les septénaires se répètent dans tous les domaines : les couleurs du spectre sont au nombre de sept, et la musique compte sept mouvements (do, ré, mi, fa, sol, la, si). Certains les notent de un à sept, d'autres par une alternance conditionnelle entre le mouvement et le silence, comme dans les anciennes notations arabes.
Si vous examinez de près, vous trouverez également que les détails de la musique sont présents dans d'autres éléments. Si vous dites "un" en mathématiques, vous pouvez dire "un demi", "un quart", "un huitième", et ainsi de suite. C'est la même chose pour la couleur : les couleurs du spectre sont sept, mais le jaune n'est pas un degré unique, ni le rouge. Chaque couleur est composée d'une infinité de degrés.
C'est ce qu'a établi Ibn Hazm al-Andalusî dans son étonnant ouvrage, la Lettre sur les Couleurs (Risâlat al-Alwân), afin de démontrer qu'il y a le non-couleur et toutes les couleurs, comme l'a dit le mystique : "Nous sommes un peuple qui voit la conjonction (al-jam') dans l'essence de la différence (al-farq)."
La Poliphonie et le Secret de la Nuance
Cette multiplicité absolue est indiquée par la musique. Dans le monde arabe, par exemple, notre musique est décrite comme appartenant à une échelle quart-de-ton (as-sullam ar-rubâ'î). La musique de la Grande Asie et d'une partie de l'Afrique est décrite comme pentatonique, et la musique européenne comme heptatonique (sept notes).
Mais pourquoi la musique arabe est-elle septénaire ? L'échelle septénaire vous permet la nuance sur une seule note. C'est pourquoi nous avons le quart-de-ton, le demi-quart-de-ton, à l'infini. Votre musique possède donc une spécificité liée à votre culture, votre histoire et votre environnement propre, et il en va de même pour la musique en Europe. Mais toutes ces musiques s'imbriquent et s'interfèrent considérablement.
La musique, dans sa définition essentielle, n'est rien d'autre que des croissances polyphoniques. Le terme polyphonique signifie la multiplicité, tandis que la croissance est une ascension. Toute ascension mène également à une descente, selon l'expression : « Il s'approcha et descendit ». L'approche et la descente ont ici un sens très profond, à l'image du fruit qui penche sous son propre poids – un signe de maturité – parce qu'il porte le bien en lui.
Ceci est la musique, en très bref, bien sûr. Je vous renvoie ici à un nouveau livre de moi qui paraîtra ces jours-ci, intitulé Croissances Polyphoniques, une lecture horizontale de la relation entre la musique et les autres genres artistiques.
L'Appréciation Esthétique : L'Abstraction Contre la Figuration
Lors de mon récent voyage à Paris, j'ai observé, au Musée du Louvre, une femme âgée assise devant un tableau, le contemplant profondément. J'ai suivi cette scène avec étonnement : le temps s'écoulait pendant qu'elle méditait sur l'œuvre, ce qui a soulevé chez moi la question du goût et de l'appréciation artistique. J'ai eu le sentiment que, dans le monde arabe, nous ne connaissons pas la véritable jouissance esthétique. Qu'est-ce que l'appréciation esthétique ?
Pour répondre à cette question, ou pour éclaircir les enjeux de l'appréciation esthétique, il faut savoir que les civilisations humaines ont emprunté des voies multiples. Sur chacun de ces chemins, une culture donnée a exercé une prédominance, qu'elle soit de nature thématique ou personnelle.
Dans l'Europe historique, la culture des arts visuels était spécifiquement associée à la figuration (at-tajsîm). Cette figuration fut inspirée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle était liée à la mythologie, à la légende, aux approches religieuses, métaphoriques et métaphysiques, et aux manières d'envisager l'invisible (ghaybî).
Deux Trajectoires Inverses : Figuration vs. Abstraction
Par contre, dans le monde arabe, et plus précisément dans la culture arabo-islamique, nous sommes partis d'emblée de l'Abstraction (at-tajrîd).
Les Européens ont cheminé vers l'abstraction en passant par la figuration — un processus qui est devenu toute une histoire en soi — pour atteindre l'abstraction dans les arts modernes, avec ses divers symboles et formes.
Nous, dès le début, avons privilégié l'abstraction. Notre culture repose sur le principe que l'absent est plus important que le présent, le caché plus important que l'apparent, et le métaphorique plus important que le réel. C'est pourquoi cette culture visuelle s'est manifestée dans l'appréciation du langage, de la lettre (calligraphie), de l'ornementation (az-zukhrafa), des miniatures et des motifs décoratifs.
Notre trajectoire fut donc totalement inverse. Nous sommes allés directement à l'extrême (l'abstraction), tandis qu'ils ont traversé des étapes successives pour y parvenir. Cela signifie que la sensibilité artistique existait chez nous comme chez eux. Cette dualité n'est ni fermée ni rigide, car les arts européens après la Renaissance ont commencé à emprunter ou à intégrer certains éléments décoratifs et abstraits des arts islamiques. Ce fut le cas à Venise, ou dans les interactions entre l'Empire ottoman et de nombreux pays européens. Cette tendance était également régie par la lettre arabe et les impératifs esthétiques de la calligraphie, comme nous l'avons constaté dans le Rococo ou le Baroque, par exemple. Bien que ces écoles soient intrinsèquement européennes, elles furent clairement influencées par la culture et les arts islamiques.
L'Unité Culturelle Méditerranéenne et la Spécificité Arabe
Quant à la musique, le sujet serait long. Quoi qu'il en soit, la sensibilité artistique est par nature spécifique, mais elle est aussi complexe du fait de l'interactivité horizontale. Les peuples qui partagent le bassin méditerranéen ont toujours été proches historiquement. La mer a servi de lien entre l'Afrique du Nord, l'Asie arabe et l'Europe. Ce partage historique a conduit à un degré très élevé de friction culturelle entre la civilisation arabe historique et la civilisation européenne.
Les pays proches du sud de l'Europe (Portugais, Espagnols, Maltais, Italiens, etc.) sont probablement les plus influencés. Nous pouvons donc parler, au sens historique, d'une unicité culturelle au sein de la multiplicité, tout en parlant également de spécificités culturelles illimitées, non seulement entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi au sein des régions arabes et européennes. Par conséquent, nous suivons une trajectoire d'appréciation artistique tout à fait comparable à la leur.
Toutefois, dans notre pratique et notre maîtrise artistique, nous nous sommes appliqués à développer l'écriture calligraphique et l'ornementation, et à convoquer des éléments importants liés aux espaces vides (comme dans l'architecture des mosquées) ou à ce que j'appelle l'encombrement esthétique (l'exubérance décorative), comme dans l'art de la décoration.

Ascension et Déclin des Civilisations : La Loi du Centre de Gravité
Il y a quelques heures, je discutais avec des collègues de l'ascension et du déclin des civilisations. Nous parlions de l'ancienne civilisation égyptienne et de la façon dont elle a atteint son apogée il y a sept mille ans. Que s'est-il passé ? J'aimerais que vous nous éclairiez sur la philosophie de l'ascension et du déclin des civilisations?
Historiquement, j'assimile la civilisation humaine à un centre de gravité dynamique et mobile. Ce centre de gravité se déplace d'un lieu à un autre. Ce centre fut dans le monde arabe après les conquêtes islamiques, notamment à l'époque abbasside, puis il s'est déplacé vers l'Europe, et il se déplace maintenant vers l'Asie.
Nous sommes face à une réalité à la fois physique et existentielle, qui signifie que la civilisation humaine est dans un mouvement dynamique constant. Nous n'aurions jamais pu imaginer, par exemple, dans les années 1960 ou 1970, que la Chine serait ce qu'elle est aujourd'hui. C'est comme si le centre de gravité civilisationnel s'était rendu en Chine, et qu'elle était devenue une usine pour le monde, et non plus seulement pour elle-même, une agriculture pour le monde, et une source de découvertes scientifiques pour l'humanité entière. Qui aurait pu s'attendre à ce que la Chine, considérée comme un pays en développement jusqu'au tournant du millénaire, devienne aujourd'hui la première en Intelligence Artificielle, en inventions, en industrie, et dans tant d'autres domaines ?
Les Prémisses du Déplacement du Centre de Gravité
Cela signifie que le centre de gravité s'est déplacé là-bas, mais il ne se déplace pas pour des raisons métaphysiques ou fantaisistes. Il se déplace parce que des prémisses ont été établies dans cet environnement particulier.
En Chine, des prémisses rationnelles et sages ont été établies, permettant un développement et une croissance intelligents qui combinent les avantages du centralisme social (protection des citoyens) et les avantages de la décentralisation (dynamisme horizontal dans le développement), comme ils ont commencé à le faire avec ce qu'ils appelaient les Quatre Modernisations dans les années 1970.
De nombreux observateurs se moquaient alors de cette idée. Puis ils ont mis en œuvre une véritable et grande révolution éducative, en se concentrant sur l'aspect qualitatif de l'enseignement, ce qui se manifeste aujourd'hui clairement dans les découvertes scientifiques innombrables qui ont lieu en Chine.
Ensuite, Deng Xiaoping est arrivé. Il a dit : "Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris." Il voulait dire par là que nous adopterions les principes socialistes pour assurer la protection sociale des êtres humains et l'égalité d'une société sans pauvres ni démunis, tout en cherchant à élever les gens au niveau de la classe moyenne. Mais nous adopterions aussi le dynamisme vital de l'économie selon une méthode de décentralisation complète dans le développement et l'économie. C'est pourquoi ils ont ouvert les portes à tous les investissements mondiaux.
Aujourd'hui, dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, 80 % des activités de l'entreprise américaine Apple se déroulent en Chine. Et il en va de même pour les constructeurs automobiles allemands et autres. Par conséquent, toutes ces mesures protectionnistes prises en faveur de certaines économies aux États-Unis ont un impact négatif sur le consommateur et l'industriel américain, car la Chine a devancé tous ces problèmes grâce à une libéralisation économique avisée et rationnelle qui reconnaît l'interdépendance et l'intérêt mutuel.
Un Avenir Décentralisé
C'est là l'idée du prélude au mouvement du centre de gravité civilisationnel d'une région à l'autre dans le monde. Aujourd'hui, dans le contexte de l'espace ouvert, des satellites qui offrent de nombreux services vitaux, du rapprochement des distances et des relations entre les gens et les sciences, et des moteurs de recherche capables de faire des miracles (traductions, créations d'images, etc.), dans toutes ces conditions, je m'attends à ce que chaque village et chaque point du monde puisse se connecter à l'ère moderne, être efficace et être en concurrence pour attirer le centre de gravité civilisationnel.
Aujourd'hui, nous parlons du Vietnam, par exemple, comme d'un pays concurrent dans les industries légères. Par conséquent, dans le monde arabe, nous devons prêter attention à cette question, tirer profit de ces expériences, et considérer la profondeur humaine de notre région comme un atout majeur pour le développement contemporain. Car lorsque vous sécurisez votre marché intérieur à 60 % ou 70 %, vous savez avec certitude que vous êtes sur la bonne voie. La civilisation n'est pas une donnée structurelle et bâtie, mais une réalité humaine complexe.
Le Sens Profond de la Culture : Entre Matière et Esprit
La renaissance est une culture, et le sous-développement est une culture. Quelle est la philosophie de la culture et son rôle dans le traitement des crises et des problèmes ?
La Culture est l'un de ces termes qui ne peut être défini de manière rigide ou procédurale. La culture englobe toutes les valeurs matérielles et spirituelles au sein d'une société humaine, quelle qu'elle soit. Chaque société humaine porte en elle et dans les replis de sa mémoire ce que l'on appelle les valeurs matérielles et spirituelles globales.
Par conséquent, la Culture se détache du concept élitiste et restreint de l'intelligentsia pour englober une notion plus large à laquelle tous les individus de la société contribuent.
C'est pourquoi les historiens et les philosophes ont toujours parlé de l'existence sociale des êtres humains comme du levier principal de la conscience sociale. En d'autres termes, la vie matérielle des gens est le créateur d'une vie spirituelle morale. Imaginez ceux qui vivent dans la pauvreté la plus sordide dans le monde : ils ne peuvent être la cause de la création de valeurs spirituelles nobles et élevées. Seuls ceux qui mènent une vie digne et équilibrée — ni sordide, ni dissolue, mais entre ces deux extrêmes — sont capables de bâtir des valeurs civilisationnelles et humaines nobles.
Nous pouvons donc dire que la Culture, en un sens, est cette chimie magique qui mêle la conscience et l'existence de manière positive. Elle fait de la conscience le véritable interprète de cette existence sociale mouvante et positive, et elle soumet les élites politiques qui détiennent le pouvoir aux lois de la géographie et de l'histoire. C'est dans ce contexte que la culture s'épanouit pleinement.
La Relativité et les Vertus de l'Environnement
Cependant, cela n'empêche en rien que de petites sociétés aient leur propre culture et des épanouissements spécifiques. Les exemples sont très nombreux. Lorsque les Arabes étaient confinés dans la péninsule, au cœur du désert, ils ont produit une éloquence (bayân) sans pareille sur Terre : une éloquence poétique, en prose, orale et mémorielle, régie par une oralité créatrice et extraordinaire.
Chaque environnement sur Terre possède donc des avantages comparatifs potentiels. Ces avantages sont ceux qui ont permis, par exemple, le grand épanouissement et le rayonnement du Romantisme en Europe, car l'environnement européen lui-même est romantique, avec ses fleurs, ses oiseaux, sa verdure et son eau. Mais l'environnement désertique arabe a également créé une culture d'abstraction, d'imagination et de perspicacité (firâsa). L'ensemble de ces éléments a créé ce type d'éloquence, ce type de poésie, ce type de miracle (i'jâz) qui a atteint son apogée dans le Saint Coran.
La valeur miraculeuse du Coran est une valeur verbale, linguistique, orale, autorisée — appelez-la comme vous voulez. Et l'une des sources de cette valeur est que ce choix divin pour ce désert avait une signification particulière.
La Culture est Contestation et Profondeur
Par conséquent, nous devons savoir que la Culture ne peut être définie sans cesse. Une fois la définition connue, nous devons redéfinir le défini. Nous sommes donc dans une suite définitionnelle incessante.
La Culture conteste ce qui est tout fait (al-jâhiz), elle s'oppose aux procédures formelles, elle se refuse aux stéréotypes. La Culture est globale. Le monde entier contribue donc à son développement. Nous pouvons, par exemple, observer dans certaines jungles africaines des formes de présence culturelle étonnantes qui dépassent de loin le sommet des cultures humaines ailleurs.
Considérez, par exemple, les instruments à vent dans la musique. On dit qu'ils sont des instruments du cœur et de l'âme, car ils interagissent avec le souffle humain. Comme le disait Cheikh Muhyi ad-Dîn Ibn 'Arabî : "Les souffles des créatures sont les chemins vers Dieu" — des souffles illimités qui mènent à la Vérité.
Dans des régions reculées d'Afrique, certains utilisent des instruments à vent où l'on contrôle les sept mélodies non pas par un mouvement mécanique ou par les trous habituels, mais uniquement par le contrôle de la respiration de l'homme, à travers une cavité graduée. Cela n'existe ni dans la musique moderne ni dans la musique patrimoniale que nous connaissons. C'est extraordinaire, car cela montre que l'être humain peut créer la structure mélodique musicale uniquement par son souffle, sans les manipulations habituelles sur les sept notes.
Cela signifie que la Culture est latente dans tout ce que nous considérons comme inconnu et lointain. Celui qui veut développer les termes de la Culture doit donc revenir aux origines, aux premières et importantes amulettes. C'est ainsi qu'est la Culture.
La Philosophie du Bonheur : Une Énigme Existentielle
C'est la question qui a tourmenté tous les hommes, riches et pauvres, et à laquelle les philosophes et les écrivains ont tenté de répondre sans qu'une réponse claire n'émerge jusqu'à présent : Qu'est-ce que le bonheur au sens véritable et philosophique du terme ?
C'est une question qui n'a pas de réponse, car le Bonheur est, de toute façon, un concept. C'est un concept lié à l'Existence, or l'Existence est double : il y a l'Existence concrète, que nous voyons et percevons, cette existence physique des choses, et qui contient un tunnel qui vous mène à l'autre Existence, celle qui se détache du monde matériel ou physico-biologique.
Le bonheur réside précisément dans les contradictions qui fusionnent simultanément. Ce qui semble douloureux, d'une certaine manière, ne l'est pas. Ce qui semble inacceptable ou insatisfaisant peut receler en son sein un grand bien.
L'Unité des Contraires : L'Exemple de l'Eau
Pour tenter de nous rapprocher d'une définition du bonheur, nous devons méditer sur la composition des éléments. Prenons l'exemple de l'eau : elle est composée d'un atome d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. L'atome d'hydrogène est inflammable, il brûle d'un feu ardent. L'atome d'oxygène est celui qui favorise l'inflammation, permettant à l'étincelle d'embraser une plaine entière. Or, lorsque ces deux atomes s'unissent, ils se transforment en eau, qui éteint le feu.
C'est là la vérité existentielle : en toute chose réside son exact opposé. Et l'eau, qui nous apparaît comme un bienfait immense, contient en son sein l'oxygène et l'hydrogène, c'est-à-dire le feu ardent et les incendies.
C'est pourquoi Cheikh Muhyi ad-Dîn Ibn 'Arabî disait : "Ce qui de mon feu vous atteint est lumière... Ainsi, la lumière éternise les flammes." Il entend par là que ce feu que vous voyez est, en dernière analyse, ce qui crée la lumière. Dans notre conception, le feu ne détruit pas nécessairement, mais la lumière qui éclaire une lampe traditionnelle est une simple ignition dans un filament, qui se transforme en lumière. Et c'est cette lumière qui éternise le feu.
De ce point de vue, nous pouvons tâtonner sur les chemins du bonheur. Le bonheur ne peut être mesuré de manière standardisée, temporelle ou hédonique, car la jouissance (al-iltithâdh) est liée à la douceur (al-'uthûba), dont la source est le doux (al-'adhb). Mais la souffrance (al-'adhâb) a également sa source dans le doux (al-'adhb). La souffrance est parfois douce.
La Jeunesse Arabe : Entre Ancrage et Flux Numériques
La Jeunesse Arabe est prise en étau entre les valeurs ancestrales et des courants occidentaux . Quelle lecture philosophique faites-vous de ce dilemme existentiel ? Quel cap doit prendre la nouvelle génération arabe, et quelle est la feuille de route la plus sûre pour son parcours ?
Avant d'aborder les affres de la jeunesse et de dresser le constat des sociétés humaines contemporaines, nous devons reconnaître que celles-ci continuent d'opérer des rappels et des emprunts constants aux éléments d'intégration et d'interconnexion des différentes cultures. Cette dynamique s'exprime cependant aujourd'hui avec une acuité et un caractère pour ainsi dire radical dans la communication, l'imbrication et l'échange des éléments culturels variés.
J'estime que la jeunesse, et plus particulièrement les plus jeunes d'entre eux qui sont à l'aube de leur vie, jouissent d'une sensibilité intimement liée à la conjoncture actuelle. Cette sensibilité s'apparente à des capteurs de détection ou des sondes, qui enregistrent de manière absolument verticale tout ce qui les entoure.
En conséquence, il incombe aux familles et aux institutions sociétales de tout État une responsabilité exceptionnelle concernant la manière d'orienter les jeunes, ou de les aider à naviguer dans ces eaux chahutées. Ces eaux sont par nature agitées, car elles pulvérisent les barrières que nous avons connues tout au long de l'histoire. Certes, ces barrières n'étaient jamais absolues, mais elles maintenaient au moins une distance procédurale entre le local et l'universel, l'identité régionale et le moi local singulier.
Or, nous constatons aujourd'hui que les outils numériques, l'intelligence artificielle et l'ensemble des médiums aux multiples lances qui assiègent l'individu partout, interpellent la jeunesse plus que les aînés. L'impact sur cette jeunesse est, pour ainsi dire, tragique. Cette influence repose largement sur une dextérité technique à capter les signaux et à saisir les différentes dimensions du monde. Elle n'est toutefois pas fondée sur une connaissance profonde ni sur la fortification intellectuelle nécessaire.
Ceci nous amène in fine à affirmer l'absolue nécessité de posséder une vision quant à la manière d'aider les plus jeunes à naviguer dans ces eaux agitées que nous avons nommées.
Pour les y aider, ils doivent évoluer au sein de ce que l'on pourrait appeler des sociétés parallèles. En d'autres termes, ils doivent impérativement cultiver un lien avec leur communauté locale spécifique, même si celle-ci est rurale. Ils doivent être connectés à leur culture propre d'une manière radicalement qualitative, qu'il s'agisse de la langue en particulier et des schémas de l'expression linguistique humaine au sens large du terme, ce qui englobe les formes, les couleurs, la musique, la poésie et tout ce qui s'y apparente.
Ils doivent également avoir des bras étendus vers les différentes cultures humaines dont la présence, que nous le voulions ou non, est manifeste dans la vie contemporaine. C'est ainsi que la nouvelle génération pourra développer une capacité d'interaction multidimensionnelle avec ces réalités et s'en trouver plus ou moins immunisée. Car si nous les laissons en pâture à la société globale et aux multimédias, ils risquent fortement de s'égarer. Deux cultures dissemblables, voire antagonistes, pourraient alors naître : soit une appartenance radicale et fanatique où le jeune recherche une particularité identitaire locale, nationale et religieuse d'une manière outrancièrement excessive ; soit un relâchement moral et un abandon de tout ce qui a trait aux valeurs civilisationnelles, culturelles et aux héritages positifs.
Pour qu'un dialogue constructif et dialectique puisse s'établir entre ces deux niveaux, la sagesse est requise, et la sagesse est le bien perdu du croyant qui cherche à la retrouver.
Dans ces conditions, nous ne pouvons proposer ni formule magique ni recette infaillible pour aider les jeunes à naviguer dans cette époque. Ce qui est requis, c'est la pluralité systémique dans le rapport aux cultures et aux territoires différents, sans jamais négliger l'importance et la nécessité d'un retour à la communauté locale la plus spécifique et particulière, fût-elle un petit village, une colline de montagne ou un lieu isolé dans le désert. Ces ancrages sont des questions cruciales qui ont un impact profond sur l'équilibre personnel, la confiance en soi et la contribution positive à la création d'alternatives et d'options de vie appropriées.
Décryptage des Lois de l'Art
Tout art possède ses propres règles. Pourriez-vous analyser les fondements de ces règles ? Dans quels cas est-il possible de les transgresser, et quelles sont les conditions requises pour une véritable innovation artistique ?
L'équation artistique est, par nature, une équation composite. Si nous l'abordons, nous ferons face à des schémas différents et multiples, mais simultanément unifiés par la programmation ou le programme fondamental qui régit l'ensemble de ces arts.
Ce programme fondamental revêt des appellations diverses. On parle, par exemple, de l'algorithme mathématique, ou de l'harmonie dans le cas de la construction d'un récit narratif ou de l'élaboration d'une grande phrase musicale, et ainsi de suite. Cela s'applique également au niveau de la mélodie – au sens de l'accord complet – où je n'entends pas seulement l'aspect musical, mais où la mélodie englobe aussi les dimensions plastiques, l'écriture littéraire, etc.
Dès lors que nous captons ces éléments qui imbriquent directement ou indirectement les différentes formes d'art, nous réalisons que tous ces arts partagent la norme de la balance esthétique, pour ainsi dire. Cette balance esthétique est atteinte à travers une série de règles cruciales, incluant, par exemple, la composition et la structure, ainsi que l'antithèse ou le contraste. Les contrastes sont fondamentaux dans tous les arts ; l'antithèse signifie l'expressivité résultant de la collision entre deux niveaux opposés. Or, cette collision peut être bénigne car elle recherche un rythme mesuré.
L'harmonie est également un point essentiel, tant au sein d'un genre artistique donné qu'entre différents genres, de sorte que nous pouvons peindre un tableau en convoquant implicitement la musique, composer un air en convoquant implicitement les mathématiques, ou rédiger un texte narratif en convoquant implicitement la poétique au sens large du terme.
L'Unité et la Balance Cosmique
En considérant ces correspondances entre les différents arts et littératures – bien que dans le monde arabe nous opérions une distinction entre les deux, la vérité étant que la littérature fait partie des arts – cette forme d'union collective, concernant le porteur universel ou le logiciel dans le langage contemporain, indique sans équivoque que nous devons entretenir un lien avec l'esthétique de la forme et l'esthétique du contenu simultanément.
En d'autres termes, les deux esthétiques (forme et contenu) sont le levier majeur de l'essence de la critique, de l'évaluation, de l'arbitrage, de la singularité de tel ou tel art, et de son historicité. Car l'historicité signifie la vérification, la description et la classification en rapport au temps et à l'espace de cet art. Il en va de même pour les grandes questions existentielles, qui sont intrinsèquement philosophiques, qu'il s'agisse du sens de l'existence directe ou du sens ontologique dual qui combine l'existence visible et l'existence absente, ou encore la matière et la métaphysique dans le langage des Européens.
Jābir ibn Hayyān l'a révélée dans une large mesure en associant la Balance à toutes les entités des possibles (A'yān al-Mumkināt) dans l'existence – un terme soufi signifiant que tout ce qui est possible est à la fois possible et non possible ; tout ce qui est existant est existant et absent ; tout ce qui est présent est présent et absent.
Jābir ibn Hayyān a donc parlé de la Balance au sens le plus global du terme. La Balance est tout ce qui s'ordonne dans cette existence. Mais cet ordre est relatif, et non absolu, car nous ne pouvons saisir l'essence de cet ordre dans sa totalité. Si nous saisissions cet ordre dans son entièreté, nous saisirions l'essence de l'existence, ce qui nous est impossible car nous sommes dans le cadre d'une question dont la réponse ne finit jamais. Dans le cadre d'une question d'où découlent des questions sans limite connue. Par conséquent, la Balance apparaît aussi comme une forme de spontanéité, une forme de chaos.
Le Chaos Apprivoisé : L'Harmonie Secrète du Visible
Aujourd'hui, avec la photographie électronique, il a été découvert que les nuages, que nous voyons se mouvoir librement dans le ciel, se déplacent d'une manière très typique et ordinaire, semblant spontanés jusqu'à un certain point. Il a été prouvé que ces nuages sont régis par des lois physiques, légales et formelles qui, en fin de compte, confirment qu'ils sont parfaitement harmonisés, tout comme les forêts. De même, nous voyons les forêts comme des masses où s'entremêlent de nombreux éléments visuels et des formes illimitées.
Mais si ces forêts sont photographiées électroniquement à distance, elles s'ordonnent d'une manière incroyablement précise et systématique. C'est exactement comme la spontanéité absolue de l'aile du papillon qui s'ordonne dans un schéma esthétique, ou comme les différentes formes des pierres d'agate nobles qui s'ordonnent esthétiquement, sans qu'aucune ne ressemble à l'autre et qui peuvent paraître être un chaos visuel ; mais ce n'est pas un chaos visuel du tout.
Par conséquent, toutes ces questions nous mènent à une seule vérité : ces différents arts puisent leurs éléments structurels, formels, chromatiques, scripturaux et mélodiques – nommez-les comme vous voulez – dans le réservoir de cette grande amulette magique qui réside au fondement des lois de l'existence que Dieu nous a octroyées.
La Philosophie des Langues et l'Unité du Verbe
Quelle est la philosophie qui régit la formation des langues, comment expliquer leur essor ou leur déclin, et quelle est la raison de leur interpénétration et de leurs similitudes ?
C'est une question d'une importance capitale. Tous les linguistes et tous ceux qui s'intéressent aux différentes langues humaines ont longuement médité sur ce sujet, aboutissant à une multitude de théories. Cependant, en dernière analyse, et d'après ce que j'observe dans le champ des sciences du langage, je dirais que l'impulsion originelle vient de l'instauration existentielle dans ce cosmos. Lorsque Dieu a créé l'Homme, il l'a créé en tant que porteur du langage.
Qu'est-ce que le langage pour l'être humain ou l'Adamique ? Le langage est pour nous une vocalisation mesurée (un son rythmé) basée sur la règle du mouvement et du repos. Cette alternance rythmique entre mouvement et repos est liée à la capacité d'articulation et à la possibilité de produire des sons. La production de sons est elle-même liée à la respiration, à l'ouïe, et à la vue. C'est-à-dire que nous n'émettons pas un son sans regarder quelque chose que nous voulons exprimer ou à qui nous voulons adresser la parole. Nous n'exprimons pas une opinion sans avoir entendu quelque chose, et ainsi de suite.
C'est comme si les sens humains formaient une armée mobilisée dans tout le corps humain afin de produire un son. D'où le verset coranique : « Il a créé l'Homme. Il lui a appris à s'exprimer (al-Bayân). » La source fondamentale est donc l'Homme. La balance fondamentale de l'être humain est unique, et le programme de base sur lequel l'être humain repose, que ce soit du point de vue anatomique, biologique, historique ou psychologique, est unique.
L'unicité de ce programme implique, in fine, l'unicité des langues. L'humanité est une, et les langues sont une. Certes, les individus sont divers, mais cette diversité n'est pas seulement chromatique (de couleur) ; elle est une dans l'essence : tous possèdent nez, yeux et oreilles.
Mais cette diversité est infinie ; elle ne se limite pas aux races et aux schémas ethniques, car chaque individu est singulier et particulier. Il ne ressemble ni à son fils, ni à son père, ni à son oncle. Chacun possède une empreinte propre. Cette empreinte, nous la voyons aujourd'hui dans les empreintes digitales et l'iris, mais elle est présente en toute chose, y compris la voix, l'ouïe et les capacités. Dieu a créé le monde selon un programme unique et unifié, mais multiplié à l'infini.
C'est parce que nous saisissons ces différences infinies que nous connaissons la vérité, et c'est parce que nous rassemblons ces éléments, car ils sont régis par un programme unique, que nous adorons Dieu, car c'est Lui qui a diffusé ce programme dans le cosmos et l'existence depuis l'éternité et pour toujours.
Du Verbe à l'Architecture Géométrique
Nous arrivons donc à un point unique : l'oralité, les sons sont le fondement de l'expression. Le fondement de ces sons est la structure humaine constitutive de l'individu. Ces sons sont organisés au sens linguistique du terme, mais ils empruntent également d'autres éléments additionnels qui jouent le rôle du hardware informatique : les mains, les doigts, les yeux, et tous ces éléments jouent un rôle dans l'expression humaine. Puis, le langage prend son essor.
Dans ce cas, nous procédons tous du même programme. Ici résident les mérites de chaque langue. Chaque langue humaine possède des avantages comparatifs qui peuvent être amplifiés, modérés, ou diminués.
Je pense que la langue arabe a des avantages comparatifs amplifiés. Ceci n'est pas un fanatisme pour la langue arabe, mais le résultat d'une relation particulière avec d'autres langues humaines. L'arabe possède de très nombreuses particularités linguistiques ; le développement sur ces spécificités serait long. J'ai d'ailleurs fait quelques références à ces dimensions que je ne souhaite pas reprendre ici dans un récent ouvrage intitulé L'Arabe entre le regardé et l'écrit "L'Arabe entre le Visible et l'Écrit"
En fin de compte, nous considérons la langue à travers des niveaux multiples : le langage est parole, son, et une véritable construction géométrique. Le langage est musique, et de véritables algorithmes algébriques. Le langage emprunte ses éléments à toutes les composantes de la nature.
Le langage est un et multiple, au point que même le chant des oiseaux n'est pas uniforme. Nous pourrions croire que les oiseaux de telle ou telle espèce ont un chant unique, mais en réalité, chacun a sa propre voix, et ainsi de suite.
Dans ce sens, nous pouvons comprendre que la langue est un état qui exprime l'Être (la Kénōse). Non pas seulement la phrase dans sa globalité, mais chacune de ses lettres.
La lettre unique est un état qui exprime l'Être absolu. Les linguistes et ceux qui ont conceptualisé la langue comme une oralité transformée en image l'ont représentée dans les formes qui s'incarnent dans les différentes écritures.
Ceci renvoie également à une recherche graphologique sur l'essence du langage. Dans chaque lettre, qu'elle soit arabe, latine, ou autre, nous pouvons apercevoir dans chaque langue l'image même.
La Philosophie de la Création : Au-delà du Cliché de l'Érudition
Certains véhiculent une image stéréotypée du créateur, exigeant qu'il soit érudit et cultivé. Or, nous observons que la création émerge aussi bien chez des illettrés que chez des individus simples. Quelle est, selon vous, la véritable philosophie de l'acte créatif ?
La création est un état de débordement (un flux) issu d'une accumulation. Ces débordements sont de nature lumineuse et proviennent d'une accumulation à la fois cognitive et pratique.
La connaissance qui n'émane que de la pratique pure est incomplète, ou en chemin vers la complétude. La connaissance qui dérive uniquement du savoir au sens épistémologique du terme est également lacunaire. La connaissance qui fusionne la culture savante, la profession, la pratique et l'expérience atteint, plus ou moins, sa plénitude. En fin de compte, l'être humain est le dépositaire de cette intégration.
L'énergie intellectuelle, spirituelle et mentale de l'Homme est le support de cette capacité à fusionner les éléments disparates qui s'entrechoquent violemment et travaillent au plus profond de l'individu tel un volcan en éruption.
Par conséquent, la création est une sorte d'étincelle qui allume la gâchette de la pensée, celle du dépassement constant, de la combustion et de l'embrasement. C'est pourquoi de nombreux génies à travers le monde ont quitté la vie terrestre très tôt ; ils n'avaient pas l'énergie nécessaire pour réconcilier l'existence extérieure avec leur état intérieur singulier. Les raisons et considérations à cet égard sont nombreuses.
Mais in fine, la création est un état de transgression, un état de dépassement, c'est un flux. Soit ce flux jaillit de manière volcanique, comme une éruption, soit il advient de manière graduelle, comme les crues des fleuves, car ces inondations mènent à la fertilisation et à une croissance formidable. La rivière a débordé, mais d'une manière non volcanique ou sismique, par exemple. C'est ce qui se passe dans la vie des créateurs.
Le Prix de la Transgression et la Rareté des Novateurs
Certains s'arrêtent aux limites de ce qu'ils connaissent et de ce à quoi ils se sont habitués. Ils plantent leurs tentes dans les plaines du familier, dans l'enceinte de l'aisance avec le convenu. Ceux-là n'apportent finalement rien de nouveau. Ils peuvent être de bons revivalistes, d'excellents éducateurs, ou d'honnêtes enseignants.
Mais ceux qui introduisent la nouveauté dans le monde de la culture, de la création et de la pensée sont rares. Souvent, ils ne sont pas reconnus par le grand public, ni même par certains cercles élitistes. C'est le cas de nombreuses figures méconnues de l'histoire, qui ont même été confrontées à de graves problèmes, comme Giordano Bruno en Italie, ou Colin Wilson qui est décédé récemment en Grande-Bretagne et qui n'a jamais été pleinement reconnu par les milieux académiques et élitistes, car ils le jugeaient trop excentrique. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr.
La Création et la Souffrance
Nous restons dans l'espace de la création. La question porte à présent sur une ancienne théorie critique selon laquelle la souffrance serait la source ou la matrice de l'expérience poétique sincère. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?
Tout le monde souffre. La souffrance est un état de contrainte existentielle inéluctable. C'est comme si, dans cette vie, nous étions voués à la lutte et aux difficultés. Par conséquent, ce qui se déroule sur terre – et en dernière analyse – ce qui nous apparaît comme une bénédiction peut être une calamité ou en contenir une grande. Et ce qui semble être de la peine et de l'effort peut receler le bonheur de l'accomplissement ou la joie de la capacité d'agir.
Il n'y a donc pas de définition absolue du sens du plaisir dans la vie, ni de définition absolue du sens de la lutte . Ces définitions nécessitent d'être définies elles-mêmes – une définition de la définition, si l'on peut dire – car, en fin de compte, il n'y a pas de définition.
Nous prenons plaisir à ces boissons et ces nourritures, mais in fine, nous aspirons à ce qui est invisible, dont nous ignorons l'essence. Autrement dit, toute cette félicité dans laquelle nous nous trouvons est équilibrée par un mystère qui s'étend jusqu'aux oiseaux, aux mouches et aux vers qui se nourrissent de charognes. Telle est la vie.
Le fait est que l'être humain est élégant et beau dans son apparence extérieure, mais il porte en lui toutes les immondices potentielles de l'existence.
Le seul être capable de se défaire physiquement de cet état en atteignant une propreté interne et externe supérieure sont les oiseaux. C'est pour cette raison que les oiseaux volent. Le reste des bêtes ne peut pas voler, car elles sont ancrées par leurs sabots, leurs pattes et leurs corps dans la fange terrestre. Tandis que ceux qui s'affranchissent de cette fange sont ceux qui volent. C'est pourquoi Farīd ud-Dīn Aṭṭār a écrit le magnifique Langage des oiseaux (Manṭiq uṭ-Ṭayr), et l'Imam Ghazali a écrit le Traité des oiseaux (Risālat uṭ-Ṭayr). Tous deux ont abordé la symbolique de cet état existentiel et physique distinct : l'agilité, la beauté et la capacité à observer les choses d'en haut, tandis que l'Homme et les autres animaux ne peuvent se libérer de la réalité et de la gravité.
La Philosophie de la Mélancolie
La tristesse occupe une place de choix au sein de la personnalité arabe. Il y a une grande considération pour la valeur de la mélancolie, qui est parfois assimilée à la noblesse. Quelle est la philosophie arabe de cette tristesse ?
L'aliénation ou l'exil n'est pas seulement spatial ; c'est une aliénation psychologique, une condition psychologique globale. L'aliénation, au sens profond du terme, est cet état de solitude qui se heurte au collectif, que ce soit au niveau de la micro-société, de la grande société ou de l'humanité dans son ensemble.
Cette condition est inhérente à l'être humain. C'est pourquoi j'apprécie toujours ceux qui ont approfondi cette question dans le cadre des arts, comme l'Allemand Bertolt Brecht dans son théâtre. Il a cherché à exprimer l'étrangeté de l'Homme en lui-même en abolissant la distance entre le théâtre classique hérité des Grecs et son propre théâtre épique. Il a, en d'autres termes, eu recours à la distanciation (Verfremdungseffekt) à travers le texte écrit et à travers l'abolition de cette fusion ou identification extatique entre le public et la pièce.
Il alertait le public sur le fait qu'il s'agissait bien d'une représentation théâtrale. Par conséquent, il a annulé l'état de fusion totale afin de donner la victoire à la distanciation. Son objectif n'était pas seulement technique : il voulait signifier que nous devons comprendre que nous sommes des acteurs dans ce monde, comme nous jouons sur la scène, nous jouons dans la vie. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des dissimulateurs, tous des falsificateurs. C'est ce que Bertolt Brecht a voulu dire, et c'est ce qu'a exprimé dans une large mesure Gogol dans ses romans, Tchekhov dans ses nouvelles, et García Márquez dans ses écrits réalistes qualifiés de réalisme magique.
Par conséquent, l'état de tristesse est inséparable des déceptions successives qui font partie intégrante de cette vie. L'être humain est confronté à une série ininterrompue de déceptions, qu'il soit jeune ou vieux, roi ou président. Tous traversent des déceptions.
C'est pourquoi Al-Ma'arrī portait en lui une forme d'anarchisme philosophique, tout comme Schopenhauer, Nietzsche et de nombreux autres philosophes. Tous possédaient une forme de nihilisme à tendance philosophique. Un nihilisme fondé sur la reconnaissance et l'acceptation, mais une acceptation qui n'est pas fondée sur la foi au sens propre du terme. L'acceptation basée sur la foi est une acceptation des mystères et de l'impuissance à répondre aux questions, mais elle trouve une consolation dans la tentative de spiritualisation et de salut personnel.
Cependant, ceux qui ont été éprouvés par la philosophie, les lectures et la profondeur ont beaucoup souffert parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à ces questions. Ils sont donc arrivés au stade du nihilisme philosophique.
La Cacophonie des Classifications
Dans la critique littéraire et dans la vie en général, il existe une fascination pour la classification. Cela se manifeste clairement dans la critique, où l'on parle de poésie masculine et de poésie féminine, ou de sous-genres pour un seul art : poésie libre, à mètre, ou moderne. Il y a une véritable cacophonie terminologique que l'on ne retrouve pas dans d'autres cultures. Comment peut-on réguler cette question ?
La classification, la description et le classement sont une forme de simplification de la longue accumulation cognitive et pratique des genres littéraires, artistiques et des idées. Si nous retraçons, par exemple, le parcours du théâtre humain depuis celui connu dans la Grèce antique, ou les hypothèses antérieures chez les Pharaons et les Arabes, nous nous trouverons face à un immense amas de transformations, d'expériences, et de relations avec les différents genres artistiques.
Pour simplifier cette question, il est nécessaire d'établir une sorte de spatio-temporalité descriptive : on parle alors de période classique, néoclassique, romantique, impressionniste, ou moderniste. Cependant, cette classification n'épuise pas la vérité.
Ceci n'est pas seulement vrai pour la classification des sciences et des littératures, mais aussi dans le cadre de la connaissance académique pure. Celui qui cherche à connaître la science académique en tant que discipline classifiée et méthodique, au sens normatif et académique du terme, ne sera en aucun cas un créateur. Il restera un récepteur passif, assimilant et intégrant ces éléments, mais incapable de les reproduire au sens créatif du terme.
L'Ordre Académique contre la Réalité Sans Rivages
C'est pourquoi la classification et la description sont d'une importance capitale pour faciliter la compréhension de cette vaste accumulation de pratique, de connaissance et de créativité humaine nouvelle. Mais elles ne constituent pas un substitut à la vérité. La vérité absolue réside dans le fait qu'il n'existe ni murs ni barrières entre les genres artistiques. C'est ce qu'affirmait Roger Garaudy, qui a écrit dans les années 60 un livre intitulé Réalisme sans rivages, où il traitait de l'essence du réalisme dans l'art. Il y avait un débat en esthétique sur la nature du réalisme : il n'y avait pas de réalisme absolu, ni d'abstraction absolue, ni de romantisme absolu, ni de surréalisme absolu.
C'était un livre perspicace et intelligent. De même, Georg Lukács et Ernst Fischer, ainsi que de nombreux autres, ont écrit sur ce sujet. Dans le monde arabe, je n'ai pas rencontré de contributions véritablement originales dans mes lectures, à l'exception d'une femme écrivain égyptienne méconnue – et je ne comprends pas pourquoi nous l'ignorons totalement – nommée Zainab Abdelaziz. Elle a écrit un livre important sur les arts, avec une certaine approche traditionaliste, mais elle est peu connue dans la culture arabe. Je ne comprends pas pourquoi.
À part cela, je n'ai pas trouvé grand-chose de distinctif sur ce plan. Il y a eu de bonnes tentatives du Marocain Mohammed Bennis, ainsi qu'une certaine forme d'esquive chez Adonis dans certains de ses livres, comme Système et parole (النظام والكلام) et L'Orientalisme mystique (المشرقية الصوفية). Quoi qu'il en soit, ces approches critiques et esthétiques étaient fondées, pour ainsi dire, sur des fantasmes idéologiques implicites.
Le sujet est long, certes, mais il possède une écriture agile, un style appréciable, et une capacité à se présenter d'une manière ou d'une autre. Mais in fine, les contributions des Arabes à l'esthétique ne sont pas majeures.
La Règle d'Or de l'Esthétique
Par conséquent, dans le domaine de la définition personnelle, la classification, la description et la méthodologie ne sont que des outils académiques et cognitifs. Ils simplifient et facilitent la compréhension de ces choses accumulées, vastes, nombreuses et entremêlées. Mais elles ne sont en aucun cas un substitut à la vérité abstraite.
La véritable création réside précisément dans le fait de tout lire dans toute chose, de lire tous les genres dans ce genre-ci, et toutes les dimensions dans cette dimension-là.
La meilleure définition de l'esthétique est un schéma d'ordonnancement d'éléments destinés à porter des valeurs esthétiques qui s'offrent à nous. Si elles sont complètes, c'est une grande bénédiction ; si elles sont incomplètes, elles restent belles dans les deux cas.
Les exemples sont nombreux : Karl Marx, par exemple, est un métaphysicien que tous les philosophes rejettent, bien qu'il soit à la fois métaphysicien, matérialiste et dialecticien. Et ainsi de suite.
La classification, la description et le classement sont une forme de simplification de la longue accumulation cognitive et pratique des genres littéraires, artistiques et des idées. Si nous retraçons, par exemple, le parcours du théâtre humain depuis celui connu dans la Grèce antique, ou les hypothèses antérieures chez les Pharaons et les Arabes, nous nous trouverons face à un immense amas de transformations, d'expériences, et de relations avec les différents genres artistiques.
Pour simplifier cette question, il est nécessaire d'établir une sorte de spatio-temporalité descriptive : on parle alors de période classique, néoclassique, romantique, impressionniste, ou moderniste. Cependant, cette classification n'épuise pas la vérité.
Ceci n'est pas seulement vrai pour la classification des sciences et des littératures, mais aussi dans le cadre de la connaissance académique pure. Celui qui cherche à connaître la science académique en tant que discipline classifiée et méthodique, au sens normatif et académique du terme, ne sera en aucun cas un créateur. Il restera un récepteur passif, assimilant et intégrant ces éléments, mais incapable de les reproduire au sens créatif du terme.
L'Ordre Académique contre la Réalité Sans Rivages
C'est pourquoi la classification et la description sont d'une importance capitale pour faciliter la compréhension de cette vaste accumulation de pratique, de connaissance et de créativité humaine nouvelle. Mais elles ne constituent pas un substitut à la vérité. La vérité absolue réside dans le fait qu'il n'existe ni murs ni barrières entre les genres artistiques. C'est ce qu'affirmait Roger Garaudy, qui a écrit dans les années 60 un livre intitulé Réalisme sans rivages, où il traitait de l'essence du réalisme dans l'art. Il y avait un débat en esthétique sur la nature du réalisme : il n'y avait pas de réalisme absolu, ni d'abstraction absolue, ni de romantisme absolu, ni de surréalisme absolu.
C'était un livre perspicace et intelligent. De même, Georg Lukács et Ernst Fischer, ainsi que de nombreux autres, ont écrit sur ce sujet. Dans le monde arabe, je n'ai pas rencontré de contributions véritablement originales dans mes lectures, à l'exception d'une femme écrivain égyptienne méconnue – et je ne comprends pas pourquoi nous l'ignorons totalement – nommée Zainab Abdelaziz. Elle a écrit un livre important sur les arts, avec une certaine approche traditionaliste, mais elle est peu connue dans la culture arabe. Je ne comprends pas pourquoi.
À part cela, je n'ai pas trouvé grand-chose de distinctif sur ce plan. Il y a eu de bonnes tentatives du Marocain Mohammed Bennis, ainsi qu'une certaine forme d'esquive chez Adonis dans certains de ses livres, comme Système et parole et L'Orientalisme mystique . Quoi qu'il en soit, ces approches critiques et esthétiques étaient fondées, pour ainsi dire, sur des fantasmes idéologiques implicites.
Le sujet est long, certes, mais il possède une écriture agile, un style appréciable, et une capacité à se présenter d'une manière ou d'une autre. Mais in fine, les contributions des Arabes à l'esthétique ne sont pas majeures.
La Règle d'Or de l'Esthétique
Par conséquent, dans le domaine de la définition personnelle, la classification, la description et la méthodologie ne sont que des outils académiques et cognitifs. Ils simplifient et facilitent la compréhension de ces choses accumulées, vastes, nombreuses et entremêlées. Mais elles ne sont en aucun cas un substitut à la vérité abstraite.
La véritable création réside précisément dans le fait de tout lire dans toute chose, de lire tous les genres dans ce genre-ci, et toutes les dimensions dans cette dimension-là.
La meilleure définition de l'esthétique est un schéma d'ordonnancement d'éléments destinés à porter des valeurs esthétiques qui s'offrent à nous. Si elles sont complètes, c'est une grande bénédiction ; si elles sont incomplètes, elles restent belles dans les deux cas.
Les exemples sont nombreux : Karl Marx, par exemple, est un métaphysicien que tous les philosophes rejettent, bien qu'il soit à la fois métaphysicien, matérialiste et dialecticien. Et ainsi de suite.
Dans ce sens, malgré l'importance du formalisme académique, de la description, de l'analyse et de la méthodologie, ils ne sont qu'un moyen pour ouvrir des portes closes, pour entrer dans le musée de l'art, de la connaissance et de la pensée. Mais ils ne sont pas un substitut à la connaissance en soi. Je crois que celui qui souhaite connaître doit lire d'Aristote jusqu'au dernier auteur avec un esprit qui sollicite ces dimensions transcendant l'espace et le temps.
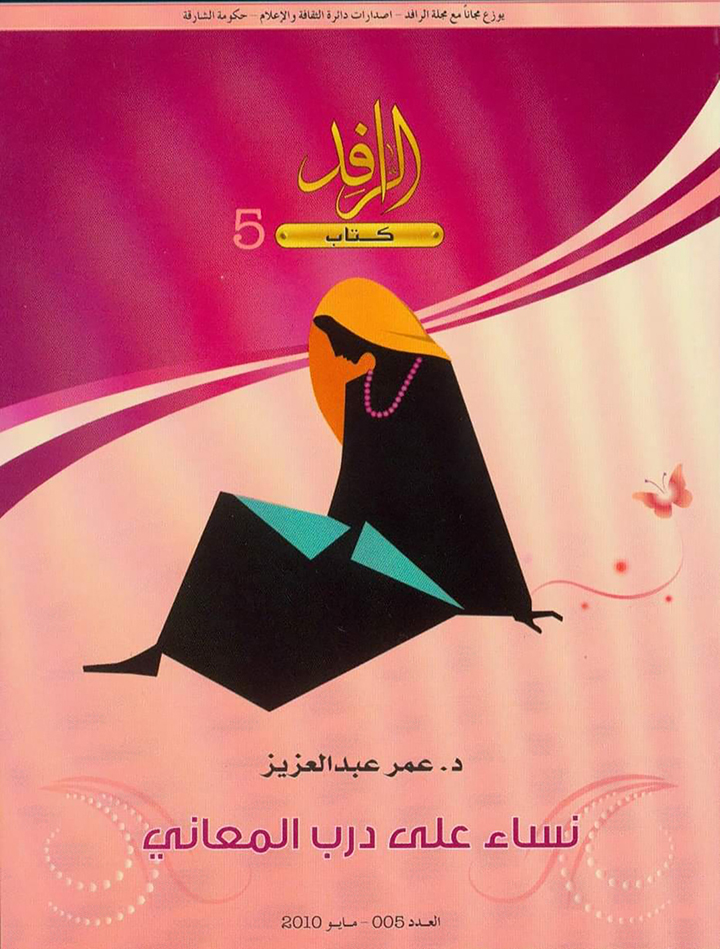
Le Secret de l'Immortalité Poétique Arabe
Lorsque nous examinons le phénomène de la persistance des arts, la poésie arabe se révèle particulièrement prégnante. Aucune autre forme – roman, nouvelle, maqâma ou muwashshaḥ – n'a atteint une telle pérennité. Seule la poésie arabe a défié le temps, à tel point que nous citons encore Al-Mutanabbī et Imrou’l-Qays. Quel est le secret de l'immortalité de la poésie ?
Premièrement, la poésie arabe est, à mon avis personnel, la contribution poétique la plus significative au monde dans son ensemble.
Deuxièmement, la poésie arabe est une expression linguistique métaphorique, une structure esthétique et une déclamation performative qui se fond avec tous les éléments du spectacle vivant. À tel point que si vous lisez un poème avec une certaine voix, vous le ressentez d'autant plus, même sans mélodie spécifique.
Historiquement, l'expression poétique chez les Arabes préislamiques reposait sur un mélange de poésie et de toutes les composantes de l'existence. Le poème était déclamé, et sa déclamation était intrinsèquement liée à une voix particulière, à une spatialité spectaculaire (ferjawiya makaniya), à une gestuelle expressive, à des allusions manuelles, aux regards, et même à l'écriture. Un homme comme Al-Ḥajjāj ibn Yūsuf ath-Thaqafī, par exemple, pouvait faire un sermon de trois heures en captivant son auditoire par son éloquence et sa manière de s'exprimer.
Il y a de nombreux exemples, même avec Gamal Abdel Nasser, qui avait un impact considérable sur tous les Arabes lorsqu'il s'adressait à eux. Il possédait un talent naturel pour la déclamation scripturale, tout comme Anwar Sadat, dans une certaine mesure. Et l'histoire en regorge.
La Civilisation du Langage
Nous sommes donc une nation dont l'émanation fondamentale est l'expression linguistique. Si la culture chinoise historique a eu son pilier essentiel ailleurs, le pilier fondamental de la civilisation arabe, avant l'Islam et son prolongement avec le Coran et l'Islam, est la Langue. Nous sommes une nation de l'éloquence (Bayân), une nation de la langue, et nous possédons par excellence une civilisation linguistique.
La civilisation hellénique grecque, fusionnée avec la Rome historique, était une civilisation de l'image ; le facteur décisif était l'image. Chez nous, le facteur déterminant était, et demeure, le Mot. Mais lorsque ce mot s'incarne dans la poésie, son impact est d'une autre nature, surtout s'il est chanté et beau.
La question ne se limite pas à la littérature générale et pure. Elle s'étend aux littératures populaires. Écoutez, par exemple, ce que chantait le défunt artiste populaire Shaaban Abdel Rahim ; il chantait en dialecte, mais ceux qui écrivaient ces paroles simples touchaient à des réalités profondes de la vie et de l'humain, ce qui produisait un grand effet en Égypte et au-delà.
Ce mot est resté un levier. L'expérience de Sheikh Imam et d'Aḥmad Fu'ād Najm y était, dans une certaine mesure, liée. L'expérience populaire dominante de Shaaban Abdel Rahim l'était également, avec des équivalents dans le monde arabe, bien que la profondeur démographique et la population de l'Égypte aient été des facteurs influents.
Si nous examinons la question, nous constatons que le levier de tout ce qu'ils disaient était la langue, et non la mélodie. La mélodie était un leitmotiv unique que le chanteur ne quittait pas. Un seul air. Mais cet air unique s'est ancré dans l'esprit des gens grâce à une pluralité systémique basée sur la multiplicité des images mentales provenant du Mot.
C'est pourquoi certains musiciens protestaient en disant : « Pourquoi ne sortez-vous pas de cet air ? Pourquoi ne pensez-vous pas à ces paroles simples qui ont un tel impact sur les gens ? » Pour eux, la mélodie était une forme, un récipient qui, bien que porteur, était multiple dans son contenu, et non un air unique.
L'Héritage Mélodique de Riyad Al-Sunbāṭī
L'expérience d'Al-Sunbāṭī dans la composition de poèmes en arabe classique est également remarquable. Riyad a véritablement intériorisé ces textes poétiques et a réussi à les exprimer de manière mélodique en lien avec les arts orientaux. Son expérience fut donc exceptionnelle. Au sens propre du terme, personne n'osait le faire, car on pensait que le public ne le comprendrait pas. Or, c'est l'inverse qui s'est produit : les gens ont écouté Al-Aṭlāl et tous les poèmes qu'il a mis en musique, impactant l'ensemble du monde arabe. Beaucoup ont commencé à composer des poèmes après Riyad Al-Sunbāṭī.
Ceci s'est produit dans toutes les régions, du Yémen au Soudan, à l'Irak, etc. Ainsi, notre langue n'est pas simple ; elle est très profonde. En tant qu'auditeur de musique, je ne retrouve pas cet aspect. La musique américaine, par exemple, repose sur une performance vocale polyphonique purement mélodique. Les paroles sont fragmentées et même similaires, mais la construction mélodique est riche, variée et sincère.















Notez ce sujet